Forum: bigfarm-fr
Board: [785] Jeux et divertissements
Topic: [51692] Mythe, conte et légende & Histoires extraordinaires
[1055256]
Bellalouna2 [None]
:: March 23, 2013, 10:43 a.m.
Merci pour ces histoires ! J'ai particulièrement aimé celle de la jeune mariée qui se suicide persuadée que son mari l'a quittée alors qu'il était simplement parti à la chasse et ne voulait pas la réveiller... Cela nous rappelle qu'un simple malentendu peut parfois devenir dramatique...
[1055274]
titevero (FR1) [None]
:: March 23, 2013, 4:44 p.m.


Le Dahu

le dahu est une créature issue d’une légende véhiculée dans certaines régions montagneuses dans l’unique but de rire de la naïveté du citadin touriste en short. Il s’agirait d’une sorte de chèvre dont les pattes d’un flanc seraient plus courtes que celles de l’autre, le mammifère étant habitué aux reliefs escarpés de la montagne. Donc le dahu on le cherche, mais on le trouve jamais...
Cette légende serait racontée par les montagnards pour se jouer de la naïveté de leurs invités novices... Après un repas bien arrosé, ils proposent à leurs invités de chasser le Dahu.
Selon les chanceux ayant aperçu le Dahu, il se situerait à mi-chemin entre le bouquetin et le chamois. Le Dahu est un animal imaginaire, aussi mystérieux que le Yéti. Il a la particularité d'avoir les pattes plus courtes d'un côté que de l'autre . Le Dahu vivant uniquement en haute-montagne, il ne se déplace que sur de fortes pentes, donc aucun souci pour se déplacer, bien au contraire!

La chasse au dahu :
Les traditions locales rapportent que cette chasse se pratique en battue, dans une forêt si possible épaisse et sombre, et même de nuit. Pour chasser le dahu, il faut un sac et des bâtons. En tapant régulièrement du bâton contre les arbres, les chasseurs effaroucheraient l'animal et parviendraient à lui faire perdre l'équilibre. C'est alors qu'interviendrait le « niais du village », posté en contrebas avec le sac ouvert, et investi par les « initiés » meilleurs connaisseurs du terrain ou meilleurs marcheurs de la mission très valorisante de capturer l'animal.
Le groupe de « rabatteurs », censé diriger l'animal vers le porteur du sac, s'éclipse en fait en abandonnant le naïf de service. Celui-ci, après s'être inquiété de ne plus entendre ses compagnons et s'être convaincu de l'inutilité de prolonger plus longtemps son attente solitaire, n'a plus qu'à rentrer seul en cherchant son chemin dans un environnement qu'il maîtrise mal.
Les montagnards partent à la chasse: il suffit de surprendre le Dahu. Dans la précipitation, le Dahu se retourne, se déséquilibre et dévale la pente. Le "novice" attend paisiblement en bas et n'a qu'à le ramasser lorsqu'il tombe en bas du versant. Après avoir attendu trop longtemps à son goût, ce dernier se retrouve à rentrer seul, dans le noir, dans un environnement qu'il connaît très mal...
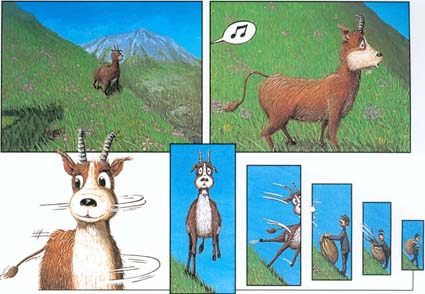
Au final, la légende du dahu a depuis longtemps perdu de son sérieux. Au XIXe siècle, sa chasse était l’occasion pour les ruraux avertis de se moquer des gens des villes à l’allure arrogante. D’ailleurs, la définition du dahu que donne le Petit Larousse illustré le démontre : « animal imaginaire à la poursuite duquel on envoie une personne crédule « . Tout est dit.
[1055280]
titevero (FR1) [None]
:: March 23, 2013, 6:11 p.m.
Le kraken

Dans notre imaginaire moderne, le kraken se présente comme un poulpe – un gros poulpe, mais à l’origine de la légende, qui se tisse dans la Scandinavie médiévale, se trouve une créature défiant toute identification.
Au mieux, les récits présentent le kraken comme un poisson ou un crustacé qui en émergeant, fait chavirer les navires, puis les entraîne dans les profondeurs lorsqu’il replonge, à cause des énormes tourbillons générés par sa masse.
Son nom norvégien, « sciu-crak », signifie d’ailleurs « crabe de mer ».
La légende du Kraken.
On se met à parler véritablement du Kraken dès le 12ème siècle de notre ère, dans des récits marins et légendes scandinaves. En fait, en Norvège on rapporte qu’un monstre à la taille gigantesque s’attaque aux navires de l’époque, les enserrant de ses bras immenses et les entraînant vers le fond, mangeant parfois quelques marins au passage.

La taille de ce monstre a toujours été surprenante dans tous les récits. Au 17ème siècle, un évêque, Erik Ludvigsen Pontoppidan, écrit dans un traité d’histoire naturelle, que le Kraken est un monstre de la taille d’une île de plus d’un kilomètre de diamètre.

Par la suite, dans les faits qui rapportent les aventures du Kraken,la taille du monstre est devenue plus petite mais sa réputation ne s’en est pas amoindrie, bien au contraire.
Il n’existe malheureusement que peu ou pas de représentation du Kraken avant le 18ème siècle, c’est à dire l’arrivée des naturalistes. Ces derniers avancent quelques théories. Ils pensent que le Kraken serait en fait un poulpe géant, peut-être même un calmar géant. C’est depuis ces théories que l’on commence à créer certaines représentations du Kraken.
On ne compte plus les récits rapportant la taille et les performances du Kraken depuis le 18ème siècle. Bien des théologiens ainsi que des zoologues décrivent la bête parfois comme une créature à la forme d’un poisson plat, d’autres, à la forme d’une baleine, mais tous s’accordent à dire qu’elle est munie de nombreux bras puissants et sa taille est énorme. Ce qu’il y a d’amusant, c’est que certaines études d’ecclésiastiques, notamment l’évêque, Erik Ludvigsen Pontoppidan, présentent la bête comme une créature vivante et non pas comme un monstre des enfers.
La réputation du Kraken est telle que certains l’associent à une divinité. On la fuit ou on l’adore. Des marins assurent que sa présence peut garantir les prises de pêche les plus fantastiques si l’on sait l’approcher au bon moment.
C’est pourtant le très sérieux journal «The Times» qui, en 1874, rapporte que la goélette Pearl venait d’être coulée par un calmar géant. Or, il s’avère aujourd’hui que cet événement n’était qu’un canular car la goélette Pearl n’a jamais existé. Mais ces quelques lignes ont renforcé cette légende une fois de plus. Ce fait divers a toutefois inspiré les aventures extraordinaires de Jack Sparrow et de son Black Pearl.

Le Kraken - Géant des profondeurs
Jusqu’au XIXe siècle, les récits de marins relatant l’existence de céphalopodes gigantesques, laissaient indifférents les hommes de sciences qui n’y voient que racontars et superstitions. Il faudra attendre 1861, lorsque le navire français Alecton se retrouve au large de Ténérife, aux prises avec un calamar de 5 mètres de long, pour que l’existence de ces géants soit enfin prise au sérieux.
 La première photographie d’un calamar géant
La première photographie d’un calamar géant
Durant les deux siècles suivants, on collectionne les carcasses échouées ou flottantes au gré des courants. Le seul matériel disponible, car personne ou presque n’a croisé de spécimen vivant d’« Architeuthis dux ». Parmi les dizaines d’expéditions lancées à sa poursuite, la plupart sont rentrées bredouilles... Ce n'est qu'en 2004 qu’un zoologue japonais, Tsunemi Kubodera, ramène la première photo sous-marine d’un calamar géant.
De cet animal, on sait qu’il peut atteindre une longueur de plus de 20m, car il a la particularité de continuer à grandir tout au long de son existence. On sait également qu’il en existe deux espèces. La première plutôt trapue, l’autre plus allongée et présentant deux longs tentacules pouvant atteindre la moitié de sa taille et dont les ventouses sont garnies de crochets. Enfin, on suppose que son seul prédateur est le cachalot, un mammifère marin de 30 tonnes qui, contrairement aux équipes de recherche, n’hésite pas à plonger à 2000 mètres de fond pour capturer son repas.
Aujourd’hui avec le recul et les expériences de notre époque, nous pourrions penser que tous ces récits historiques sont le fait de l’exagération de la taille de baleines, pieuvres ou calmars géants ayant eu maille à partir avec des équipages de l’époque.
Nous avons tous entendu parler des mésaventures d’Olivier de Kersauzon qui en 2003,a dû interrompre sa course lorsqu’un calmar géant s’agrippa à son bateau. Le bateau ne coula pas mais l’emprise fut telle que la poursuite de la course devenait périlleuse avec une telle charge sous la coque.
Il est également très surprenant de voir les cicatrices laissées sur le dos de certains cachalots ou baleines, par des calmars géants.
Quoi qu’il en soit, nous ne saurons jamais exactement si les calmars géants découverts aujourd’hui et qui ont atteint la taille de 20 mètres, en tenant compte des tentacules, sont les petits cousins du Kraken !
Le Kraken ! Un calamar géant filmé pour la première fois !

Ce monstre marin étonnant est un Architeuthis (ou Kraken comme l’appelait les vikings). On savait que le Kraken n’était pas un animal mythique. Des calamars géants ont déjà été capturés, en général, près de la surface de l’eau. Mais c’est la première fois qu’un calamar géant a été filmé dans son environnement à 900 mètres de fond.
Sa peau argentée brille sous la lumière du submersible. Il observe le sous-marin avec suspicion. Selon le directeur de mission, Tsunemi Kubodera :
Il était brillant et superbe. J’étais tellement excité quand je l’ai vu au début, mais j’avais confiance. Je savais que nous allions le voir parce que nous avions cherché les zones où nous pouvions le trouver avec rigueur, en nous basant sur d’anciennes données. Les chercheurs du monde entier ont essayé de filmer le calamar géant dans son habitat naturel, mais toutes les tentatives ont été vaines jusqu’à aujourd’hui.
Le calmar géant a été filmé dans les profondeurs de l’océan Pacifique par une équipe de trois scientifiques japonais coincés dans un sous-marin de recherche pendant 400 heures après 100 missions. L’équipe a localisé le monstre à 15 km de l’ile Chichi, un petit archipel à 240 km au nord d’Iwo Jima.
Kubodera a réussi à trouver un autre calamar en 2006, mais ce n’était pas un Architeuthis, mais un Taningia danae. Le Taningia, une bête rouge avec 8 bras, est un peu plus petit que l’Architeuthis. Et il y a un autre monstre qui n’a pas encore été filmé, et qui est encore plus gros que l’Architeuthis, c’est le Mesonychoteuthis.

Dans notre imaginaire moderne, le kraken se présente comme un poulpe – un gros poulpe, mais à l’origine de la légende, qui se tisse dans la Scandinavie médiévale, se trouve une créature défiant toute identification.
Au mieux, les récits présentent le kraken comme un poisson ou un crustacé qui en émergeant, fait chavirer les navires, puis les entraîne dans les profondeurs lorsqu’il replonge, à cause des énormes tourbillons générés par sa masse.
Son nom norvégien, « sciu-crak », signifie d’ailleurs « crabe de mer ».
La légende du Kraken.
On se met à parler véritablement du Kraken dès le 12ème siècle de notre ère, dans des récits marins et légendes scandinaves. En fait, en Norvège on rapporte qu’un monstre à la taille gigantesque s’attaque aux navires de l’époque, les enserrant de ses bras immenses et les entraînant vers le fond, mangeant parfois quelques marins au passage.

La taille de ce monstre a toujours été surprenante dans tous les récits. Au 17ème siècle, un évêque, Erik Ludvigsen Pontoppidan, écrit dans un traité d’histoire naturelle, que le Kraken est un monstre de la taille d’une île de plus d’un kilomètre de diamètre.

Par la suite, dans les faits qui rapportent les aventures du Kraken,la taille du monstre est devenue plus petite mais sa réputation ne s’en est pas amoindrie, bien au contraire.
Il n’existe malheureusement que peu ou pas de représentation du Kraken avant le 18ème siècle, c’est à dire l’arrivée des naturalistes. Ces derniers avancent quelques théories. Ils pensent que le Kraken serait en fait un poulpe géant, peut-être même un calmar géant. C’est depuis ces théories que l’on commence à créer certaines représentations du Kraken.
On ne compte plus les récits rapportant la taille et les performances du Kraken depuis le 18ème siècle. Bien des théologiens ainsi que des zoologues décrivent la bête parfois comme une créature à la forme d’un poisson plat, d’autres, à la forme d’une baleine, mais tous s’accordent à dire qu’elle est munie de nombreux bras puissants et sa taille est énorme. Ce qu’il y a d’amusant, c’est que certaines études d’ecclésiastiques, notamment l’évêque, Erik Ludvigsen Pontoppidan, présentent la bête comme une créature vivante et non pas comme un monstre des enfers.
La réputation du Kraken est telle que certains l’associent à une divinité. On la fuit ou on l’adore. Des marins assurent que sa présence peut garantir les prises de pêche les plus fantastiques si l’on sait l’approcher au bon moment.
C’est pourtant le très sérieux journal «The Times» qui, en 1874, rapporte que la goélette Pearl venait d’être coulée par un calmar géant. Or, il s’avère aujourd’hui que cet événement n’était qu’un canular car la goélette Pearl n’a jamais existé. Mais ces quelques lignes ont renforcé cette légende une fois de plus. Ce fait divers a toutefois inspiré les aventures extraordinaires de Jack Sparrow et de son Black Pearl.

Le Kraken - Géant des profondeurs
Jusqu’au XIXe siècle, les récits de marins relatant l’existence de céphalopodes gigantesques, laissaient indifférents les hommes de sciences qui n’y voient que racontars et superstitions. Il faudra attendre 1861, lorsque le navire français Alecton se retrouve au large de Ténérife, aux prises avec un calamar de 5 mètres de long, pour que l’existence de ces géants soit enfin prise au sérieux.
 La première photographie d’un calamar géant
La première photographie d’un calamar géantDurant les deux siècles suivants, on collectionne les carcasses échouées ou flottantes au gré des courants. Le seul matériel disponible, car personne ou presque n’a croisé de spécimen vivant d’« Architeuthis dux ». Parmi les dizaines d’expéditions lancées à sa poursuite, la plupart sont rentrées bredouilles... Ce n'est qu'en 2004 qu’un zoologue japonais, Tsunemi Kubodera, ramène la première photo sous-marine d’un calamar géant.
De cet animal, on sait qu’il peut atteindre une longueur de plus de 20m, car il a la particularité de continuer à grandir tout au long de son existence. On sait également qu’il en existe deux espèces. La première plutôt trapue, l’autre plus allongée et présentant deux longs tentacules pouvant atteindre la moitié de sa taille et dont les ventouses sont garnies de crochets. Enfin, on suppose que son seul prédateur est le cachalot, un mammifère marin de 30 tonnes qui, contrairement aux équipes de recherche, n’hésite pas à plonger à 2000 mètres de fond pour capturer son repas.
Aujourd’hui avec le recul et les expériences de notre époque, nous pourrions penser que tous ces récits historiques sont le fait de l’exagération de la taille de baleines, pieuvres ou calmars géants ayant eu maille à partir avec des équipages de l’époque.
Nous avons tous entendu parler des mésaventures d’Olivier de Kersauzon qui en 2003,a dû interrompre sa course lorsqu’un calmar géant s’agrippa à son bateau. Le bateau ne coula pas mais l’emprise fut telle que la poursuite de la course devenait périlleuse avec une telle charge sous la coque.
Il est également très surprenant de voir les cicatrices laissées sur le dos de certains cachalots ou baleines, par des calmars géants.
Quoi qu’il en soit, nous ne saurons jamais exactement si les calmars géants découverts aujourd’hui et qui ont atteint la taille de 20 mètres, en tenant compte des tentacules, sont les petits cousins du Kraken !
Le Kraken ! Un calamar géant filmé pour la première fois !

Ce monstre marin étonnant est un Architeuthis (ou Kraken comme l’appelait les vikings). On savait que le Kraken n’était pas un animal mythique. Des calamars géants ont déjà été capturés, en général, près de la surface de l’eau. Mais c’est la première fois qu’un calamar géant a été filmé dans son environnement à 900 mètres de fond.
Sa peau argentée brille sous la lumière du submersible. Il observe le sous-marin avec suspicion. Selon le directeur de mission, Tsunemi Kubodera :
Il était brillant et superbe. J’étais tellement excité quand je l’ai vu au début, mais j’avais confiance. Je savais que nous allions le voir parce que nous avions cherché les zones où nous pouvions le trouver avec rigueur, en nous basant sur d’anciennes données. Les chercheurs du monde entier ont essayé de filmer le calamar géant dans son habitat naturel, mais toutes les tentatives ont été vaines jusqu’à aujourd’hui.
Le calmar géant a été filmé dans les profondeurs de l’océan Pacifique par une équipe de trois scientifiques japonais coincés dans un sous-marin de recherche pendant 400 heures après 100 missions. L’équipe a localisé le monstre à 15 km de l’ile Chichi, un petit archipel à 240 km au nord d’Iwo Jima.
Kubodera a réussi à trouver un autre calamar en 2006, mais ce n’était pas un Architeuthis, mais un Taningia danae. Le Taningia, une bête rouge avec 8 bras, est un peu plus petit que l’Architeuthis. Et il y a un autre monstre qui n’a pas encore été filmé, et qui est encore plus gros que l’Architeuthis, c’est le Mesonychoteuthis.
[1055286]
titevero (FR1) [None]
:: March 23, 2013, 7:07 p.m.
Vague scélérates: un mythe légendaire

Voici un reportage proposé par la chaîne Thalassa sur un mythe qui effraie tous les marins depuis des siècles. On retrouve beaucoup d'histoire sur des bateaux qui ont disparu dans les océans sans laisser aucun indice derrière eux.
Le München étaient un bateau aussi long que deux terrains de football, il était réputé pour être le meilleur navire au monde. Le 7 décembre 1978, le cargos prend la mer pour un voyage vers l'Amérique. À bord, 27 membres d'équipages dont Uwe Hinrichs qui a 20 ans et ne tarie pas d'éloges sur le navire. Le München avait l'habitude d'affronter le mauvais temps, mais le 12 décembre 1978, à 3heures du matin, l'équipage a envoyé un message SOS, car ils sont en difficultés et réclament de l'aide. Un avion de chasse et des bateaux partent à la recherche du navire sur une large zone. C'est la plus grosse opération de sauvetage. Arrivée sur les lieux du drame, ils ne retrouvent quasiment rien, juste un canot de sauvetage vide et quelques débris. Tout le reste à totalement disparut.
Une enquête est ouverte pour comprendre le naufrage du München, des spécialistes scrutent à la loupe les plans du bateau, les débris et le canot de sauvetage. Celui-ci fournit un indice sur ce qui a bien pu se passer cette nuit là. Un canot de sauvetage est suspendu à 20 mètres au-dessus de la ligne de flottaison et repose sur une attache métallique. Celle du canot du München est plié d'avant en arrière, ce qui signifie que le navire a dû être frapper par une force spectaculaire. Personne ne sait d'où vient cette force. De ce fait, la commission conclut à un naufrage dû au mauvais temps.
Malgré les conclusions de la commission d'enquête, beaucoup de marins pensent savoir ce qui est arrivé au cargos allemand. Tous pensent qu'une vague gigantesque aurait engloutit le navire. Une légende dit que cette vague engloutit tout sur son passage et celle-ci est appelé: Vagues Scélérates. Cette vague est un grand mythe des océans, certains parlent de vague de la taille d'un grand immeuble qui surgit de nulle part, elle n'est ni un tsunamis, ni un raz de marée et personne ne sait comment elle se forme.
Pour les océanographes, les vagues scélérates sont quasiment impossible à apparaitre. Les scientifiques expliquent comment ce forme la houle, c'est-à-dire, plus le vent est fort, plus la houle est grosse. Pour prévoir la hauteur des vagues lors d'une tempête, les scientifiques se servent d'opérations mathématiques appelé modèles linéaires et avec ce calcul, ils démontrent qu'il y a une limite dans a hauteur des vagues, ils en déduisent alors que les vagues scélérates ne sont forcément qu'une légende. Même dans les pires tempêtes, les vagues peuvent atteindre un maximum de 12 mètres et la probabilité de la flotte sont conçue d'après ce modèle linéaire et chaque disparition mystérieuse à la même conclusion, ou c'est dû à la corrosion, ou à une erreur humaine.
Mais le 31 décembre 1995, toutes leurs théories tombent à l'eau. Dans la mer du nord, à 160 km des côtes se trouvent une plate-forme pétrolière et ce jour de nouvel de nouvel ans, une tempête frappe la plate-forme. Des capteurs détectent des vagues de 12 mètres, jusqu'à ce qu'une lame de 30 mètres de hauts environ frappe de pleins fouets la plate-forme. C'est grâce à ce jour que les scientifiques ont enfin accepté la possibilité des vagues scélérates. Maintenant, il fallait trouver les raisons de la formation de celle-ci, car pour l'industrie naval, cette nouvelle est catastrophique. Des milliards d'euro sont en jeux et les scientifiques doivent mettre tout en œuvre pour trouver le moyen de les prévoir. Ils commencent par lister les endroits où elles sont apparue. Les scientifiques s'orientent vers le lieu le plus réputer pour ses vagues gigantesques sur des routes maritimes très fréquentés, en Afrique du Sud. Un spécialiste des sauvetages en Afrique du Sud a été témoins des ravages que ces lames ont pu causer. Depuis 1990, vingts bateaux ont été détruit par des vagues scélérates au large de l'Afrique du Sud. Des chercheurs relèvent tous les endroits où se sont produits tous les accidents sur une carte, ils la disposent sur une image numérique de l'océan et constatent que tous les accidents correspondent au courant des aiguilles. Celui-ci descend tout le long de l'Afrique du Sud en provenance de l'océan indien, il est plus chaud que le reste de l'océan. Seul le courant des aiguilles ne devrait pas soulever de vagues extrême, mais parfois, il rencontre un vent et une houle à sens inverse et c'est ce qui serait à l'origine des vagues scélérates.
Grâce à un satellite radar, ils ont pu mesurer la hauteur et la force du courant et les chercheurs pensent ne pas s'être trompé sur les raisons de ces fameuses vagues. Cette théorie est reçue comme un cadeau pour l'industrie naval, car il suffirait de contourner ses courants au lieu de tout changer. Le mystère des vagues scélérates est enfin résolue jusqu'au jour où un événement en Atlantique nord remet tout en cause.
En février 2001, le Calédonien Star fait une croisière autour de l'Antarctique. Il y a 105 touristes américains et britanniques. Le bateau est censé être le plus solide du monde vu qu'il a été conçut pour résister à la glace et à des conditions extrême. Malgré de mauvaises conditions météorologiques, l'équipage n'est pas inquiet. La tempête empire et le navire est frappé par des vagues de 12 mètres de haut. Le premier maître remarque quelque chose d'anormale, il voit surgir un mur d'eau de 30 mètres arriver droit sur eux et d'une autre direction que les vagues de la tempête. À cause de cette vague, un creux énorme ce forme et le bateau tombe en chute libre, la vague recouvre entièrement la proue. Tout explosent autour de l'équipage, la vague détruit tous les instruments de navigations, mais par chance, les moteurs fonctionnent et une fois les hublots calfeutrés, le navire réussit à regagner le port. Dans le même temps, un bateau allemand avec 137 touristes subit le même sort, le pont est entièrement pulvérisé par une vague de 30 mètres. Plus rien ne fonctionne et le bateau part à la dérive en exposant les parties les plus fragiles aux vagues de la tempête. L'équipage met tout en œuvre pour redresser le bateau, car avec une tempête 6°C, il est impossible de sortir les canots. Ils arrivent à réparer un moteur et regagnent le port tant bien que mal.
Dans cette zone, il n'y a aucun courant inversé qui aurait pu provoquer cette vague dévastatrice. Les scientifiques se mobilisent pour résoudre de nouveau ce mystère. Ils se servent de satellites radars et traquent toutes les vagues scélérates. Pendant trois semaines, dix vagues géantes sont repérées dans le monde. C'est avec la physique cantique que les scientifiques avancent une théorie. Celle-ci dit qu'une lame géante peut apparaitre à tout moment, celle-ci prend son énergie aux vagues voisines pour grandir. Cette hypothèse est confirmée en analysant la fameuse vague du 31 décembre.
[video]http://www.wideo.fr/video/iLyROoaft1sH.html[/video]
Les vagues scélérates se comportent de façon étrange et pour des raisons encore inconnues, elles restent encore le plus grand mystère des océans aujourd'hui.

Voici un reportage proposé par la chaîne Thalassa sur un mythe qui effraie tous les marins depuis des siècles. On retrouve beaucoup d'histoire sur des bateaux qui ont disparu dans les océans sans laisser aucun indice derrière eux.
Le München étaient un bateau aussi long que deux terrains de football, il était réputé pour être le meilleur navire au monde. Le 7 décembre 1978, le cargos prend la mer pour un voyage vers l'Amérique. À bord, 27 membres d'équipages dont Uwe Hinrichs qui a 20 ans et ne tarie pas d'éloges sur le navire. Le München avait l'habitude d'affronter le mauvais temps, mais le 12 décembre 1978, à 3heures du matin, l'équipage a envoyé un message SOS, car ils sont en difficultés et réclament de l'aide. Un avion de chasse et des bateaux partent à la recherche du navire sur une large zone. C'est la plus grosse opération de sauvetage. Arrivée sur les lieux du drame, ils ne retrouvent quasiment rien, juste un canot de sauvetage vide et quelques débris. Tout le reste à totalement disparut.
Une enquête est ouverte pour comprendre le naufrage du München, des spécialistes scrutent à la loupe les plans du bateau, les débris et le canot de sauvetage. Celui-ci fournit un indice sur ce qui a bien pu se passer cette nuit là. Un canot de sauvetage est suspendu à 20 mètres au-dessus de la ligne de flottaison et repose sur une attache métallique. Celle du canot du München est plié d'avant en arrière, ce qui signifie que le navire a dû être frapper par une force spectaculaire. Personne ne sait d'où vient cette force. De ce fait, la commission conclut à un naufrage dû au mauvais temps.
Malgré les conclusions de la commission d'enquête, beaucoup de marins pensent savoir ce qui est arrivé au cargos allemand. Tous pensent qu'une vague gigantesque aurait engloutit le navire. Une légende dit que cette vague engloutit tout sur son passage et celle-ci est appelé: Vagues Scélérates. Cette vague est un grand mythe des océans, certains parlent de vague de la taille d'un grand immeuble qui surgit de nulle part, elle n'est ni un tsunamis, ni un raz de marée et personne ne sait comment elle se forme.
Pour les océanographes, les vagues scélérates sont quasiment impossible à apparaitre. Les scientifiques expliquent comment ce forme la houle, c'est-à-dire, plus le vent est fort, plus la houle est grosse. Pour prévoir la hauteur des vagues lors d'une tempête, les scientifiques se servent d'opérations mathématiques appelé modèles linéaires et avec ce calcul, ils démontrent qu'il y a une limite dans a hauteur des vagues, ils en déduisent alors que les vagues scélérates ne sont forcément qu'une légende. Même dans les pires tempêtes, les vagues peuvent atteindre un maximum de 12 mètres et la probabilité de la flotte sont conçue d'après ce modèle linéaire et chaque disparition mystérieuse à la même conclusion, ou c'est dû à la corrosion, ou à une erreur humaine.
Mais le 31 décembre 1995, toutes leurs théories tombent à l'eau. Dans la mer du nord, à 160 km des côtes se trouvent une plate-forme pétrolière et ce jour de nouvel de nouvel ans, une tempête frappe la plate-forme. Des capteurs détectent des vagues de 12 mètres, jusqu'à ce qu'une lame de 30 mètres de hauts environ frappe de pleins fouets la plate-forme. C'est grâce à ce jour que les scientifiques ont enfin accepté la possibilité des vagues scélérates. Maintenant, il fallait trouver les raisons de la formation de celle-ci, car pour l'industrie naval, cette nouvelle est catastrophique. Des milliards d'euro sont en jeux et les scientifiques doivent mettre tout en œuvre pour trouver le moyen de les prévoir. Ils commencent par lister les endroits où elles sont apparue. Les scientifiques s'orientent vers le lieu le plus réputer pour ses vagues gigantesques sur des routes maritimes très fréquentés, en Afrique du Sud. Un spécialiste des sauvetages en Afrique du Sud a été témoins des ravages que ces lames ont pu causer. Depuis 1990, vingts bateaux ont été détruit par des vagues scélérates au large de l'Afrique du Sud. Des chercheurs relèvent tous les endroits où se sont produits tous les accidents sur une carte, ils la disposent sur une image numérique de l'océan et constatent que tous les accidents correspondent au courant des aiguilles. Celui-ci descend tout le long de l'Afrique du Sud en provenance de l'océan indien, il est plus chaud que le reste de l'océan. Seul le courant des aiguilles ne devrait pas soulever de vagues extrême, mais parfois, il rencontre un vent et une houle à sens inverse et c'est ce qui serait à l'origine des vagues scélérates.
Grâce à un satellite radar, ils ont pu mesurer la hauteur et la force du courant et les chercheurs pensent ne pas s'être trompé sur les raisons de ces fameuses vagues. Cette théorie est reçue comme un cadeau pour l'industrie naval, car il suffirait de contourner ses courants au lieu de tout changer. Le mystère des vagues scélérates est enfin résolue jusqu'au jour où un événement en Atlantique nord remet tout en cause.
En février 2001, le Calédonien Star fait une croisière autour de l'Antarctique. Il y a 105 touristes américains et britanniques. Le bateau est censé être le plus solide du monde vu qu'il a été conçut pour résister à la glace et à des conditions extrême. Malgré de mauvaises conditions météorologiques, l'équipage n'est pas inquiet. La tempête empire et le navire est frappé par des vagues de 12 mètres de haut. Le premier maître remarque quelque chose d'anormale, il voit surgir un mur d'eau de 30 mètres arriver droit sur eux et d'une autre direction que les vagues de la tempête. À cause de cette vague, un creux énorme ce forme et le bateau tombe en chute libre, la vague recouvre entièrement la proue. Tout explosent autour de l'équipage, la vague détruit tous les instruments de navigations, mais par chance, les moteurs fonctionnent et une fois les hublots calfeutrés, le navire réussit à regagner le port. Dans le même temps, un bateau allemand avec 137 touristes subit le même sort, le pont est entièrement pulvérisé par une vague de 30 mètres. Plus rien ne fonctionne et le bateau part à la dérive en exposant les parties les plus fragiles aux vagues de la tempête. L'équipage met tout en œuvre pour redresser le bateau, car avec une tempête 6°C, il est impossible de sortir les canots. Ils arrivent à réparer un moteur et regagnent le port tant bien que mal.
Dans cette zone, il n'y a aucun courant inversé qui aurait pu provoquer cette vague dévastatrice. Les scientifiques se mobilisent pour résoudre de nouveau ce mystère. Ils se servent de satellites radars et traquent toutes les vagues scélérates. Pendant trois semaines, dix vagues géantes sont repérées dans le monde. C'est avec la physique cantique que les scientifiques avancent une théorie. Celle-ci dit qu'une lame géante peut apparaitre à tout moment, celle-ci prend son énergie aux vagues voisines pour grandir. Cette hypothèse est confirmée en analysant la fameuse vague du 31 décembre.
[video]http://www.wideo.fr/video/iLyROoaft1sH.html[/video]
Les vagues scélérates se comportent de façon étrange et pour des raisons encore inconnues, elles restent encore le plus grand mystère des océans aujourd'hui.
[1055292]
titevero (FR1) [None]
:: March 23, 2013, 8:38 p.m.
Créatures fantastiques Le Windigo
La légende dit qu'il s'agit d'une créature très réelle des bois, des prairies du Nord du Minnesota et des régions centrales du Canada. Les Wendigo croisent le plus souvent la route de chasseurs ou de campeurs qui s'aventurent dans des forêts éloignées mais certains lieux sont plus célèbres que d'autres pour apercevoir ces créatures. Ainsi, la ville de Kenora, au Canada a acquit le titre de "Capitale du Wendigo" en raison des multiples apparitions de Wendigo au fil des siècles.
Les indiens inuits vivant dans ces régions isolées les appellent de différentes façons, comme Witigo, Wilkio et Wee-tee-Go, mais qui veulent toutes dire "esprit du mal qui dévore l'espèce humaine".
Les Wendigo sont généralement décrits de la même façon: incroyablement mince, avec des yeux globuleux, des crocs jaunes et une très longue langue.

Certains se plaisent à penser que les Wendigo proviennent d'un croisement entre un être humain et un coyote qui tuerait les jeunes femmes à la tombée de la nuit et leur arracherait le coeur pour remplacer le sien, gelé par la perte de son grand amour.
D'autres pensent qu'il s'agirait en fait d'un humain transformé par le cannibalisme. En effet, au cours de rudes hivers, lorsque qu'un homme se retrouvait à mourir de faim, ne sachant plus quoi faire, il dévorait d'autres membres de sa tribu ou de son campement afin de survivre. De nombreuses cultures pensent que manger de la chair humaine donne des pouvoirs particuliers comme la rapidité, la force ou encore l'immortalité.
A partir de là, la personne perdrait toute son humanité et continuerait de commettre des atrocités, ne laissant aucun répit aux pauvres voyageurs qui se hasarderaient trop tardivement au milieu de la forêt.
En général, le wendigo est associé à l'hiver, lorsque la nourriture se fait rare et que les hommes sont poussés au cannibalisme en cas de grande famine ou de disette. La plupart des contes indiquent que le wendigo fait son apparition lors de la montée des grands vents froids, poussant des cris perçants et de terribles hurlements.
La plupart des contes indiquent que le windigo fait son apparition lors de la montée des grands vents froids d'hiver, poussant des cris percants et autres terribles hurlements. Certains prétendent même que le windigo est fait de glace et de froid, ou au moins son cœur. Bien que la plupart des contes aient présenté le windigo comme étant cannibale, dangereux et violent, l'« hôte » peut encore essayer de vivre loin de la civilisation, profonde dans les bois, pour empêcher quiconque d'être sa prochaine victime. Quelques personnes Windigo-habitées se suicideraient même pour éviter de blesser quelqu'un.

le phénomène du windigo est devenu plus qu'un simple mythe, certains psychologues nomment « Psychose du windigo » le fait pour un patient de montrer des signes de tendances de cannibalisme et faisant preuve d'un comportement violent et antisocial.
Comment s'en débarrasser?

Une différence réside cependant dans la manière de tuer la bête:
Certains disent que la seule façon d’en venir à bout serait de mettre le feu au corps.
D’autres encore sont d’avis qu’une arme en argent (certains disent que le fer et l'acier fonctionnent aussi) est leur ultime chance de survie face à un tel monstre, comme pour les loups garous, d'autres pensent que le meilleur moyen de les tuer est de leur arracher le coeur et de le faire fondre [car il est fait de glace ne l'oublions pas].
Pour finir, la méthode la plus sauvage consiste à briser le coeur du Wendigo avec un pieu en argent et à démembrer le corps de la bête avec une hache, elle aussi, en argent.
Les avatars modernes du Wendigo
Le Wendigo est devenu un personnage relativement courant dans les histoires d'horreur, tout comme le vampire ou le loup-garou - bien que ces descriptions fictives ne ressemblent pas beaucoup à la mythologie originale.
· L'histoire d'horreur d'Algernon Blackwood « The Wendigo » a présenté la légende comme une fiction d'horreur. L'histoire de Blackwood évite l'aspect du cannibalisme en faveur d'une psychologie plus subtile ; un thème central est que celui qui voit que le Wendigo devient le Wendigo (ou du moins quelque chose d'approchant). Le lecteur ne voit jamais le Wendigo, bien que nous soyons témoin de la déshumanisation progressif du personnage qui l'a vu. Blackwood a basé son histoire, selon lui, sur un incident réel qui s'est passé dans une vallée isolée tandis qu'il habitait au Canada et qui a créé une panique. Il a travaillé sur beaucoup de détails de la légende indienne dans cette histoire. Cependant, le Wendigo de Blackwood n'est pas un ancien humain, mais un esprit pré-humain primordial. Cette vision est en accord avec le mysticisme personnel de Blackwood.
Le livre le plus complet sur le Wendigo est l'anthologie de John Robert Colombo. Elle contient des histoires et des poésies sur le Wendigo, en grande partie inspirées par l'oeuvre de Blackwood.
Ogden Nash a écrit un poème humourisitque sur le Wendigo, où il décrit l'aspect du Wendigo. Comme l'auteur canadien Margaret Atwood le précise, la description de Nash est seulement partiellement vraie à la légende.
Dans la nouvelle de Stephen King « Pet Sematary », le cimetière éponyme marque l'emplacement d'un autre cimetière, beaucoup plus ancien, qui a été maudit par le Wendigo durant le siècle précédent. Tout cadavre enterré là pourrait être ré-animé le jour, mais seulement en tant que cannibale.
Dans le Mythe de Cthulhu créé par Lovecraft, le Wendigo est un autre titre pour Ithaqua, un des Grands Anciens Priordiaux, qui ne semble pouvoir vivre dans ces parties du monde qui sont essentiellement glacées, comme l'Alaska et l'Amérique du Nord.
Pour conclure, que ce soit un démon surnaturel des bois, l'esprit du cannibalisme, un zombi subarctique, le fantôme de la faim, un désordre de personnalité, une créature vile et sauvage ou simplement la solitude qui hante les bois pour les chasseurs perdus, personne n'est le même après la rencontre du Windigo.
Les Wndigos, d'après vous, ils existent ?
La légende dit qu'il s'agit d'une créature très réelle des bois, des prairies du Nord du Minnesota et des régions centrales du Canada. Les Wendigo croisent le plus souvent la route de chasseurs ou de campeurs qui s'aventurent dans des forêts éloignées mais certains lieux sont plus célèbres que d'autres pour apercevoir ces créatures. Ainsi, la ville de Kenora, au Canada a acquit le titre de "Capitale du Wendigo" en raison des multiples apparitions de Wendigo au fil des siècles.
Les indiens inuits vivant dans ces régions isolées les appellent de différentes façons, comme Witigo, Wilkio et Wee-tee-Go, mais qui veulent toutes dire "esprit du mal qui dévore l'espèce humaine".
Les Wendigo sont généralement décrits de la même façon: incroyablement mince, avec des yeux globuleux, des crocs jaunes et une très longue langue.

Certains se plaisent à penser que les Wendigo proviennent d'un croisement entre un être humain et un coyote qui tuerait les jeunes femmes à la tombée de la nuit et leur arracherait le coeur pour remplacer le sien, gelé par la perte de son grand amour.
D'autres pensent qu'il s'agirait en fait d'un humain transformé par le cannibalisme. En effet, au cours de rudes hivers, lorsque qu'un homme se retrouvait à mourir de faim, ne sachant plus quoi faire, il dévorait d'autres membres de sa tribu ou de son campement afin de survivre. De nombreuses cultures pensent que manger de la chair humaine donne des pouvoirs particuliers comme la rapidité, la force ou encore l'immortalité.
A partir de là, la personne perdrait toute son humanité et continuerait de commettre des atrocités, ne laissant aucun répit aux pauvres voyageurs qui se hasarderaient trop tardivement au milieu de la forêt.
En général, le wendigo est associé à l'hiver, lorsque la nourriture se fait rare et que les hommes sont poussés au cannibalisme en cas de grande famine ou de disette. La plupart des contes indiquent que le wendigo fait son apparition lors de la montée des grands vents froids, poussant des cris perçants et de terribles hurlements.
La plupart des contes indiquent que le windigo fait son apparition lors de la montée des grands vents froids d'hiver, poussant des cris percants et autres terribles hurlements. Certains prétendent même que le windigo est fait de glace et de froid, ou au moins son cœur. Bien que la plupart des contes aient présenté le windigo comme étant cannibale, dangereux et violent, l'« hôte » peut encore essayer de vivre loin de la civilisation, profonde dans les bois, pour empêcher quiconque d'être sa prochaine victime. Quelques personnes Windigo-habitées se suicideraient même pour éviter de blesser quelqu'un.

le phénomène du windigo est devenu plus qu'un simple mythe, certains psychologues nomment « Psychose du windigo » le fait pour un patient de montrer des signes de tendances de cannibalisme et faisant preuve d'un comportement violent et antisocial.
Comment s'en débarrasser?

Une différence réside cependant dans la manière de tuer la bête:
Certains disent que la seule façon d’en venir à bout serait de mettre le feu au corps.
D’autres encore sont d’avis qu’une arme en argent (certains disent que le fer et l'acier fonctionnent aussi) est leur ultime chance de survie face à un tel monstre, comme pour les loups garous, d'autres pensent que le meilleur moyen de les tuer est de leur arracher le coeur et de le faire fondre [car il est fait de glace ne l'oublions pas].
Pour finir, la méthode la plus sauvage consiste à briser le coeur du Wendigo avec un pieu en argent et à démembrer le corps de la bête avec une hache, elle aussi, en argent.
Les avatars modernes du Wendigo
Le Wendigo est devenu un personnage relativement courant dans les histoires d'horreur, tout comme le vampire ou le loup-garou - bien que ces descriptions fictives ne ressemblent pas beaucoup à la mythologie originale.
· L'histoire d'horreur d'Algernon Blackwood « The Wendigo » a présenté la légende comme une fiction d'horreur. L'histoire de Blackwood évite l'aspect du cannibalisme en faveur d'une psychologie plus subtile ; un thème central est que celui qui voit que le Wendigo devient le Wendigo (ou du moins quelque chose d'approchant). Le lecteur ne voit jamais le Wendigo, bien que nous soyons témoin de la déshumanisation progressif du personnage qui l'a vu. Blackwood a basé son histoire, selon lui, sur un incident réel qui s'est passé dans une vallée isolée tandis qu'il habitait au Canada et qui a créé une panique. Il a travaillé sur beaucoup de détails de la légende indienne dans cette histoire. Cependant, le Wendigo de Blackwood n'est pas un ancien humain, mais un esprit pré-humain primordial. Cette vision est en accord avec le mysticisme personnel de Blackwood.
Le livre le plus complet sur le Wendigo est l'anthologie de John Robert Colombo. Elle contient des histoires et des poésies sur le Wendigo, en grande partie inspirées par l'oeuvre de Blackwood.
Ogden Nash a écrit un poème humourisitque sur le Wendigo, où il décrit l'aspect du Wendigo. Comme l'auteur canadien Margaret Atwood le précise, la description de Nash est seulement partiellement vraie à la légende.
Dans la nouvelle de Stephen King « Pet Sematary », le cimetière éponyme marque l'emplacement d'un autre cimetière, beaucoup plus ancien, qui a été maudit par le Wendigo durant le siècle précédent. Tout cadavre enterré là pourrait être ré-animé le jour, mais seulement en tant que cannibale.
Dans le Mythe de Cthulhu créé par Lovecraft, le Wendigo est un autre titre pour Ithaqua, un des Grands Anciens Priordiaux, qui ne semble pouvoir vivre dans ces parties du monde qui sont essentiellement glacées, comme l'Alaska et l'Amérique du Nord.
Pour conclure, que ce soit un démon surnaturel des bois, l'esprit du cannibalisme, un zombi subarctique, le fantôme de la faim, un désordre de personnalité, une créature vile et sauvage ou simplement la solitude qui hante les bois pour les chasseurs perdus, personne n'est le même après la rencontre du Windigo.
Les Wndigos, d'après vous, ils existent ?
[1055297]
titevero (FR1) [None]
:: March 23, 2013, 10:19 p.m.
Les vouivres

Appelées aussi "faux dragons". Créatures imaginaires nées dans l'Est de la France, elles hantaient les marais.
Le mythe de la vouivre est né en Franche-Comté. Le mot vouivre vient du latin vipera signifiant serpent. Effectivement, la vouivre est un grand serpent de plusieurs mètres, pourvu de courtes ailes. Son corps est écailleux, lui offrant une solide protection. En plus d'attaquer ses victimes à coup de dents, peut cracher du feu et donner de terribles coups de queue.
Les Vouivres ont une double apparence, tantôt elles peuvent se montrer sous la forme d'une splendide naïade !

Légende
Les puits servent souvent de repaire à des serpents fantastiques ; celui qui est bien connu dans l'Est sous le nom de vouivre, se tient parfois dans ceux de Franche-Comté.
L'un de ces dragons ailés habitait au milieu des ruines du château de Vernon, dans la Côte-d'Or, un puits aujourd'hui rempli par les décombres. Une femme du pays, venue pour cueillir de l'herbe dans la cour de ce château, le jour de la Fête-Dieu, avait apporté son enfant et l'avait déposé sur la terre. Mais elle avait à peine commencé son ouvrage qu’elle vit briller sur la pelouse une grande quantité de pièces d'argent ; elle s'empressa de les ramasser et d'en remplir son tablier. De retour à la maison, elle se débarrassa de son argent et s'aperçut qu’elle avait oublié son enfant ; elle retourna le chercher, mais il avait disparu. Elle alla lors consulter le curé de Laroche-en-Breil, qui sut que c'était la vouivre qui avait enlevé l'enfant ; il dit alors à la mère de conserver exactement l'argent et surtout de ne pas y toucher pour le rapporter l'année suivante, le même jour et à la même heure, et qu'alors la vouivre lui rendrait son nourrisson. Elle fit exactement ce que lui avait conseillé le curé, et elle retrouva son enfant bien portant et grandi, assis à la même place où elle l'avait déposé l’année précédente.

La vouivre, qui se montre aussi sur le bord des étangs et des ruisseaux, est le plus merveilleux et le plus connu des reptiles qui hantent les fontaines. Xavier Marmier et D. Monnier pensaient que ce serpent fabuleux était particulier à la Franche-Comté. Depuis on l'a retrouvé, avec le même nom, et des gestes peu différents, en Bourgogne, en Suisse et dans la vallée d'Aoste ; mais la tradition est en effet surtout répandue et bien conservée en Franche-Comté, où l'on prête à la vouivre une figure assez uniforme. C'est un serpent ailé dont le corps est couvert de feu : son œil est une escarboucle admirable dont il se sert pour se guider dans ses voyages à travers les airs. Suivant quelques témoignages oculaires, c'est un globe lumineux qui le précède d'une coudée.
La vouivre passait pour avoir sa demeure dans des grottes et dans divers autres endroits ; mais elle était aussi en relation avec les sources. L'une d’elles habitait la fontaine de la Corbière à Longchaumois (Jura), une autre se voyait à la Fontaine au Loup près de Nuits ; celle du château d'Orgelet traversait les airs, semblable à une barre de fer rouge, pour aller boire à la fontaine d'Eole ; la vouivre du château de Gemeaux (Côte-d'Or) se baignait dans la fontaine de Gemelos, entre deux et trois heures de l'après-midi : si on la surprenait, elle relevait son capuchon sur sa tête.
Lorsque ces serpents ailés avaient soif, ils déposaient leur diamant au bord de l'eau, dans la crainte de le perdre ou pour éviter qu'il fût terni. Plusieurs aventuriers essayèrent de prendre la pierre merveilleuse ; mais peu y réussirent. La vouivre qui venait autrefois se désaltérer à la source de Condes fut cependant dépouillée par un homme du pays. Il imagina de se blottir sous un cuvier et de le poser sur le diamant pendant que la vouivre était à boire. A son retour, ne trouvant plus son œil, elle se précipita avec fureur sur le cuvier. Mais le rusé villageois l'avait hérissé de grands clous dont les pointes se présentaient au-dehors, et c’est en s'y blessant à plusieurs reprises que l'aveugle serpent succomba.
Un homme de la vallée d'Aoste fit faire aussi un grand tonneau tout garni extérieurement de points de fer, le fixa solidement par une chaîne, et se cacha en attendant le dragon. Celui-ci posa le diamant à côté et but à la fontaine. L'homme sortit le bras par une fenêtre faite exprès, saisit le diamant et l'enferma subitement dans le tonneau. L'animal poussa des hurlements affreux et roula le tonneau de côté et d'autre autant que l'espace laissé par la chaîne le permettait ; à la fin il périt à force de se larder aux pointes de fer qui hérissaient le tonneau.
On s'empara par une ruse semblable de l'escarboucle, brillante comme une petite lune, du serpent-diamant de la Font de la Lyeune, que l'on nommait ainsi parce que ses ailes étaient en diamant.
La vouivre d'Isaby
Plusieurs légendes parlent d'un serpent colossal qui habitait les Pyrénées. Il était si grand que, quand sa tête reposait sur le sommet du pic du Midi, son cou s'étendait à travers Barèges, tandis que son corps remplissait toute la vallée de Luz, Saint-Sauveur et Gèdre, et sa queue était repliée dans un trou au-dessous du cirque de Gavarnie. Il ne mangeait que tous les trois mois : sans cela le pays entier aurait été dépeuplé. Par la puissante aspiration de son souffle, il attirait dans son énorme panse les troupeaux de moutons, de chèvres et de boeufs, les hommes, les femmes, les enfants, en un mot toute la population des villages. Après ces repas, il s'endormait et demeurait inerte.
Tous les hommes des vallées s'assemblèrent pour délibérer sur ce qu'il convenait de faire ; et un vieillard leur donna ce conseil : "Nous avons près de trois mois avant que le monstre ne s'éveille ; il faut couper toutes les forêts, apporter toutes les forges et tout le fer que nous possédons, allumer avec le bois une grande fournaise, puis, nous cacher dans les rochers et faire le plus de bruit possible pour éveiller le monstre".
Ce plan fut exécuté. Le serpent s'éveilla, furieux d'avoir été interrompu dans son sommeil, et voyant quelque chose qui brillait sur l'autre côté de la vallée, il l'attira par son souffle puissant, et toute la masse enflammée s'engouffra dans son vaste gosier. Aussitôt, il eut des convulsions, il brisa des rochers, fit trembler les montagnes, et mit en poussière les glaciers. Pour calmer la soif de son agonie, il descendit dans la vallée et but tous les ruisseaux, de Gavarnie à Piererfitte ; il se coucha sur le côté de la montagne et expira, et pendant que le feu qu'il avait à l'intérieur se refroidissait lentement, l'eau qu'il avait avalée coula de sa bouche et forma le lac d'Issabit (Isaby).


Appelées aussi "faux dragons". Créatures imaginaires nées dans l'Est de la France, elles hantaient les marais.
Le mythe de la vouivre est né en Franche-Comté. Le mot vouivre vient du latin vipera signifiant serpent. Effectivement, la vouivre est un grand serpent de plusieurs mètres, pourvu de courtes ailes. Son corps est écailleux, lui offrant une solide protection. En plus d'attaquer ses victimes à coup de dents, peut cracher du feu et donner de terribles coups de queue.
Les Vouivres ont une double apparence, tantôt elles peuvent se montrer sous la forme d'une splendide naïade !

Légende
Les puits servent souvent de repaire à des serpents fantastiques ; celui qui est bien connu dans l'Est sous le nom de vouivre, se tient parfois dans ceux de Franche-Comté.
L'un de ces dragons ailés habitait au milieu des ruines du château de Vernon, dans la Côte-d'Or, un puits aujourd'hui rempli par les décombres. Une femme du pays, venue pour cueillir de l'herbe dans la cour de ce château, le jour de la Fête-Dieu, avait apporté son enfant et l'avait déposé sur la terre. Mais elle avait à peine commencé son ouvrage qu’elle vit briller sur la pelouse une grande quantité de pièces d'argent ; elle s'empressa de les ramasser et d'en remplir son tablier. De retour à la maison, elle se débarrassa de son argent et s'aperçut qu’elle avait oublié son enfant ; elle retourna le chercher, mais il avait disparu. Elle alla lors consulter le curé de Laroche-en-Breil, qui sut que c'était la vouivre qui avait enlevé l'enfant ; il dit alors à la mère de conserver exactement l'argent et surtout de ne pas y toucher pour le rapporter l'année suivante, le même jour et à la même heure, et qu'alors la vouivre lui rendrait son nourrisson. Elle fit exactement ce que lui avait conseillé le curé, et elle retrouva son enfant bien portant et grandi, assis à la même place où elle l'avait déposé l’année précédente.

La vouivre, qui se montre aussi sur le bord des étangs et des ruisseaux, est le plus merveilleux et le plus connu des reptiles qui hantent les fontaines. Xavier Marmier et D. Monnier pensaient que ce serpent fabuleux était particulier à la Franche-Comté. Depuis on l'a retrouvé, avec le même nom, et des gestes peu différents, en Bourgogne, en Suisse et dans la vallée d'Aoste ; mais la tradition est en effet surtout répandue et bien conservée en Franche-Comté, où l'on prête à la vouivre une figure assez uniforme. C'est un serpent ailé dont le corps est couvert de feu : son œil est une escarboucle admirable dont il se sert pour se guider dans ses voyages à travers les airs. Suivant quelques témoignages oculaires, c'est un globe lumineux qui le précède d'une coudée.
La vouivre passait pour avoir sa demeure dans des grottes et dans divers autres endroits ; mais elle était aussi en relation avec les sources. L'une d’elles habitait la fontaine de la Corbière à Longchaumois (Jura), une autre se voyait à la Fontaine au Loup près de Nuits ; celle du château d'Orgelet traversait les airs, semblable à une barre de fer rouge, pour aller boire à la fontaine d'Eole ; la vouivre du château de Gemeaux (Côte-d'Or) se baignait dans la fontaine de Gemelos, entre deux et trois heures de l'après-midi : si on la surprenait, elle relevait son capuchon sur sa tête.
Lorsque ces serpents ailés avaient soif, ils déposaient leur diamant au bord de l'eau, dans la crainte de le perdre ou pour éviter qu'il fût terni. Plusieurs aventuriers essayèrent de prendre la pierre merveilleuse ; mais peu y réussirent. La vouivre qui venait autrefois se désaltérer à la source de Condes fut cependant dépouillée par un homme du pays. Il imagina de se blottir sous un cuvier et de le poser sur le diamant pendant que la vouivre était à boire. A son retour, ne trouvant plus son œil, elle se précipita avec fureur sur le cuvier. Mais le rusé villageois l'avait hérissé de grands clous dont les pointes se présentaient au-dehors, et c’est en s'y blessant à plusieurs reprises que l'aveugle serpent succomba.
Un homme de la vallée d'Aoste fit faire aussi un grand tonneau tout garni extérieurement de points de fer, le fixa solidement par une chaîne, et se cacha en attendant le dragon. Celui-ci posa le diamant à côté et but à la fontaine. L'homme sortit le bras par une fenêtre faite exprès, saisit le diamant et l'enferma subitement dans le tonneau. L'animal poussa des hurlements affreux et roula le tonneau de côté et d'autre autant que l'espace laissé par la chaîne le permettait ; à la fin il périt à force de se larder aux pointes de fer qui hérissaient le tonneau.
On s'empara par une ruse semblable de l'escarboucle, brillante comme une petite lune, du serpent-diamant de la Font de la Lyeune, que l'on nommait ainsi parce que ses ailes étaient en diamant.
La vouivre d'Isaby
Plusieurs légendes parlent d'un serpent colossal qui habitait les Pyrénées. Il était si grand que, quand sa tête reposait sur le sommet du pic du Midi, son cou s'étendait à travers Barèges, tandis que son corps remplissait toute la vallée de Luz, Saint-Sauveur et Gèdre, et sa queue était repliée dans un trou au-dessous du cirque de Gavarnie. Il ne mangeait que tous les trois mois : sans cela le pays entier aurait été dépeuplé. Par la puissante aspiration de son souffle, il attirait dans son énorme panse les troupeaux de moutons, de chèvres et de boeufs, les hommes, les femmes, les enfants, en un mot toute la population des villages. Après ces repas, il s'endormait et demeurait inerte.
Tous les hommes des vallées s'assemblèrent pour délibérer sur ce qu'il convenait de faire ; et un vieillard leur donna ce conseil : "Nous avons près de trois mois avant que le monstre ne s'éveille ; il faut couper toutes les forêts, apporter toutes les forges et tout le fer que nous possédons, allumer avec le bois une grande fournaise, puis, nous cacher dans les rochers et faire le plus de bruit possible pour éveiller le monstre".
Ce plan fut exécuté. Le serpent s'éveilla, furieux d'avoir été interrompu dans son sommeil, et voyant quelque chose qui brillait sur l'autre côté de la vallée, il l'attira par son souffle puissant, et toute la masse enflammée s'engouffra dans son vaste gosier. Aussitôt, il eut des convulsions, il brisa des rochers, fit trembler les montagnes, et mit en poussière les glaciers. Pour calmer la soif de son agonie, il descendit dans la vallée et but tous les ruisseaux, de Gavarnie à Piererfitte ; il se coucha sur le côté de la montagne et expira, et pendant que le feu qu'il avait à l'intérieur se refroidissait lentement, l'eau qu'il avait avalée coula de sa bouche et forma le lac d'Issabit (Isaby).

[1055317]
System [None]
:: March 24, 2013, 6:55 a.m.
Vague scélérates
passionnant reportage, je n'ai pas tout lu de tes mytes légendaires mais celui ci ma plus particuliérement.

passionnant reportage, je n'ai pas tout lu de tes mytes légendaires mais celui ci ma plus particuliérement.
[1055319]
Bellalouna2 [None]
:: March 24, 2013, 7:06 a.m.
Moi j'ai adoré les histoires sur les vouivres
[1055352]
titevero (FR1) [None]
:: March 24, 2013, 2:49 p.m.
La Légende de la Cascade des Moulines

En des temps très anciens, les nymphes des eaux et des bois vivaient très heureuses près de la Cascade des Moulines. Elles étaient vénérées par les habitants qui leurs apportaient fleurs , fruits ou menus cadeaux.
Au solstice d'été, à minuit pile, elles accordaient un unique souhait à chaque personne qui le demandait ; Il fallait donc être très prudent avant de formuler son vœu.
Ce jour-là donc, le fils du marchand le plus riche du canton, leurs ordonna de lui donner pour épouse la plus jolie fille du village. Celle-ci était éprise de son ami d'enfance un pauvre savetier et avait refusé, malgré les pressions de ses parents, les avances du vaniteux.
Les fées étaient bien embêtées car la demoiselle avait formulé, en même temps, le vœu d'épouser l'homme qu'elle aimait.
Le dilemme était posé : Lequel des deux souhaits fallait-il exaucer ? Les nymphes recherchèrent dans leur vieux grimoire la solution au problème : Rien !!!.
Heureusement une nymphe plus que centenaire, réputée sage, (mais qui n'avait pas digéré la morgue de l'arrogant solliciteur) se remémora les paroles de ses aïeules. Quand deux vœux s'opposent, seul le plus humble et le plus profond doit être pris en compte. Elles décidèrent que la liberté de choix devait revenir à la jeune fille. Celle-ci radieuse épousa son amoureux.
Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le fils du marchand sollicita des fées la possibilité d'avoir un nouveau vœu puisque le sien n'avait pu être réalisé. Celles-ci, sans méfiance, lui octroyèrent ce souhait.
"J'exige que vous soyez toutes changées en cailloux." dit-il d'une voix pleine de colère
Aussitôt dans un fracas terrible les nymphes se transformèrent en pierres. Celles-la même que vous voyez.
Quel Malheur !!!! Le torrent qui courre sur les roches de la Cascade des Moulines en pleure encore.
Heureusement, le jeune homme n'avait pas prononcé les mots terribles de "pour l'éternité" alors peut être, un jour de Saint Jean, si vous passez par la Cascade verrez-vous les nymphes danser et rire ... et si vous avez pris la précaution de vous munir des plantes sacrées et que vous murmuriez les paroles mystérieuses, peut être pourrez-vous leur faire part de votre vœu ... et peut être, si votre coeur est pur sera-t-il exaucé ...
La cascade de la Pisserote. à Arfeuilles (03)

Commençons par la légende qui entoure cette jolie cascade à étages.
Il faut savoir que la violence des eaux du Barbenan a creusé dans le granite une cuvette circulaire (le gour) où tourbillonnent les eaux froides du torrent.

"Un jour, une vieille dame du hameau du Verger voulut percer le secret du gour. Pendant de nombreuses semaines elle fila un interminable fil de laine. Elle attacha à son extrémité une pierre et la laissa glisser dans l'eau froide. Jamais elle ne toucha le fond. Alors les hommes du hameau vidèrent des tas et des tas de pierres dans le gour, qui peu à peu se combla. Depuis ce temps, le Barbenan jette ses eaux contre les pierres. En vain !"
Les corbeaux de la cascade Ville : Mortain (32767)

La scène se passe dans la vallée de la Gance, sous les murs du vieux donjon de Mortain, à l'ombre des lierres sept fois séculaires qui dérobent aux regards les sentiers de la cascade, au bruit tumultueux du torrent qui se précipite avec furie de rochers en rochers. Nul endroit n'est plus propice aux élans du coeur et nous demandons aux amis du merveilleux d'aller méditer une fois au moins dans cet asile si connu des poètes et de ceux qui recherchent les vives impressions de l'âme. La vallée est, en effet, remarquable par sa belle végétation et par son ombre mystérieuse. Deux petites rivières y forment leur jonction et marient leurs eaux murmurantes qui s'enfuient bien loin en grondant vers la Selune. Un vieux pont en bois jeté en travers relie les deux rives et conduit à une prairie émaillée de mille fleurs agrestes à peu près inconnues ailleurs que dans les sentiers peu fréquentés des Alpes. Enfin, à l'extrémité de cette prairie que bordent deux rangs de rochers gigantesques ouverts comme les feuillets d'un éventail immense, se trouve enserré le coin le plus sauvage de cette contrée si renommée par ses tableaux ravissants de fraîcheur qui l'ont fait souvent appeler la Suisse de la Normandie.
La rivière, après avoir descendu du Pas-au-Diable, et roulé de chute en chute, se tordant en nombreux méandres, sur les marches d'un gigantesque escalier naturel taillé dans un roc élevé de près de deux cents pieds, comprimée par les pieds vigoureux du rocher, se précipite d'un bond dans une colonne blanchissante d'écume et vient se briser au milieu d'éclaboussures sur une table de pierre dont les bords se dérobent sous les rameaux touffus des lierres. Elle y arrive bouillonnante et les échos répètent avec fracas le grondement perpétuel et étourdissant de la trombe d'eau qui tourbillonne longtemps dans le bassin de la vallée.

Notre légende dit que ce lieu fut témoin, il y a plusieurs siècles, d'un événement dramatique. Elle emprunte ses personnages au temps des croisades et nous dit que l'un des plus puissants seigneurs du voisinage, déjà au déclin de la vie, partit un jour pour Jérusalem après avoir confié sa fille, jeune et charmante enfant, à l'un de ses écuyers, vieux et cruel. «Frappe sans crainte et punis le parjure, lui avait-il dit, en lui ouvrant la main, si jamais Blanche vient à trahir l'honneur avant mon retour ! Veille sur elle, puisqu'elle n'a plus de mère ! » Et le geôlier avait répondu : « Maître, je vous le jure ! »
Mais les doux regards d'un jeune page eurent bientôt le talent de charmer le coeur de la triste châtelaine délaissée par son unique appui pour les lointains voyages. Longtemps Blanche et Alfred n'osèrent échanger aucune parole. Leur mutuel amour resta pendant des mois un mystère pour chacun d'eux. Celle-là n'osait se défier d'un tout jeune adolescent , beau comme elle et qui avait grandi sous les yeux d'une noble mère ; celui-ci croyait rêver du bonheur des anges et ne pouvait croire qu'aimer ainsi d'un sentiment pur et sans mélange ne fût pas autorisé de Dieu. Chaque jour ils se revoyaient avec joie et leurs derniers regards se disaient : A demain. Le temps s'écoulait en vain; leur amour printanier restait frais comme au matin où il était éclos.
L'âge d'Alfred enlevait d'ailleurs toute défiance, aussi fut-il autorisé à faire de longues promenades avec la jeune châtelaine, tantôt à pied lui offrant son bras, tantôt montés côte à côte sur de lents coursiers. Fréquemment encore ils s'égarèrent sur les bords de la rivière, dans les bois et sur les sommets des collines. Ils recherchaient surtout de préférence la cascade et ses abords solitaires. Bien souvent ils y vinrent parler du passé et se dire leurs espérances dans l'avenir. Le retour du croisé était vivement désiré d'eux : ensemble quelquefois ils priaient pour qu'il fût prochain et que leur père ratifiât des serments renouvelés vingt fois dans une heure.
Un jour, comme de jeunes enfants qu'ils étaient, assis sur la mousse, la main dans la main, coeur contre coeur, et les yeux dans les yeux, ils se dirent bien bas un mot qu'ils n'osèrent achever. Puis, les doux aveux succédèrent aux doux aveux. Le présent était enchanteur pour ces jeunes âmes à peine écloses à l'existence. Ils semblaient oublier les plus simples précautions de la prudence. Leurs soupirs, croyaient-ils, étaient étouffés par le murmure du torrent dont les flots blanchis expiraient à leurs pieds.
Soudain le vieil écuyer, que ses instincts jaloux avaient averti de la secrète flamme du jeune page et de la candide châtelaine, apparut derrière eux, au milieu des branchages des bosquets. La voix des eaux avait empêché le bruit des pas du geôlier de parvenir jusqu'à leurs oreilles.
Son bras est levé. Il va frapper ses deux victimes de son épée, et leur sang va se confondre pour punir leur forfait, lorsque le génie de ces lieux écartant le glaive meurtrier avec sa baguette, change à l'instant les deux amants en corbeaux.
Depuis cette époque, ils sont toujours ensemble. Le lierre les abrite. Rarement on les voit, mais on les entend souvent se livrer à leurs ébats joyeux. Un même nid, dit-on, les rassemble, et jamais des yeux indiscrets ne les ont obligés de le déplacer.
On prétend cependant que chaque nuit leur forme première leur est rendue et que se promenant le long des rochers et dans les vallons, depuis longtemps ils ne redoutent plus les gardiens. Durant des siècles, leur bon génie n'a cessé de veiller sur eux un seul instant et il veille toujours sur leur bonheur éternel. Aussi, lorsque vous visiterez la cascade abandonnée et solitaire, si parfois vous entendez soupirer dans le lierre, ne fuyez pas, restez, car dans ce frais et gracieux sanctuaire, les soupirs qu'on entend sont des soupirs d'amour.

En des temps très anciens, les nymphes des eaux et des bois vivaient très heureuses près de la Cascade des Moulines. Elles étaient vénérées par les habitants qui leurs apportaient fleurs , fruits ou menus cadeaux.
Au solstice d'été, à minuit pile, elles accordaient un unique souhait à chaque personne qui le demandait ; Il fallait donc être très prudent avant de formuler son vœu.
Ce jour-là donc, le fils du marchand le plus riche du canton, leurs ordonna de lui donner pour épouse la plus jolie fille du village. Celle-ci était éprise de son ami d'enfance un pauvre savetier et avait refusé, malgré les pressions de ses parents, les avances du vaniteux.
Les fées étaient bien embêtées car la demoiselle avait formulé, en même temps, le vœu d'épouser l'homme qu'elle aimait.
Le dilemme était posé : Lequel des deux souhaits fallait-il exaucer ? Les nymphes recherchèrent dans leur vieux grimoire la solution au problème : Rien !!!.
Heureusement une nymphe plus que centenaire, réputée sage, (mais qui n'avait pas digéré la morgue de l'arrogant solliciteur) se remémora les paroles de ses aïeules. Quand deux vœux s'opposent, seul le plus humble et le plus profond doit être pris en compte. Elles décidèrent que la liberté de choix devait revenir à la jeune fille. Celle-ci radieuse épousa son amoureux.
Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le fils du marchand sollicita des fées la possibilité d'avoir un nouveau vœu puisque le sien n'avait pu être réalisé. Celles-ci, sans méfiance, lui octroyèrent ce souhait.
"J'exige que vous soyez toutes changées en cailloux." dit-il d'une voix pleine de colère
Aussitôt dans un fracas terrible les nymphes se transformèrent en pierres. Celles-la même que vous voyez.
Quel Malheur !!!! Le torrent qui courre sur les roches de la Cascade des Moulines en pleure encore.
Heureusement, le jeune homme n'avait pas prononcé les mots terribles de "pour l'éternité" alors peut être, un jour de Saint Jean, si vous passez par la Cascade verrez-vous les nymphes danser et rire ... et si vous avez pris la précaution de vous munir des plantes sacrées et que vous murmuriez les paroles mystérieuses, peut être pourrez-vous leur faire part de votre vœu ... et peut être, si votre coeur est pur sera-t-il exaucé ...
La cascade de la Pisserote. à Arfeuilles (03)

Commençons par la légende qui entoure cette jolie cascade à étages.
Il faut savoir que la violence des eaux du Barbenan a creusé dans le granite une cuvette circulaire (le gour) où tourbillonnent les eaux froides du torrent.

"Un jour, une vieille dame du hameau du Verger voulut percer le secret du gour. Pendant de nombreuses semaines elle fila un interminable fil de laine. Elle attacha à son extrémité une pierre et la laissa glisser dans l'eau froide. Jamais elle ne toucha le fond. Alors les hommes du hameau vidèrent des tas et des tas de pierres dans le gour, qui peu à peu se combla. Depuis ce temps, le Barbenan jette ses eaux contre les pierres. En vain !"
Les corbeaux de la cascade Ville : Mortain (32767)

La scène se passe dans la vallée de la Gance, sous les murs du vieux donjon de Mortain, à l'ombre des lierres sept fois séculaires qui dérobent aux regards les sentiers de la cascade, au bruit tumultueux du torrent qui se précipite avec furie de rochers en rochers. Nul endroit n'est plus propice aux élans du coeur et nous demandons aux amis du merveilleux d'aller méditer une fois au moins dans cet asile si connu des poètes et de ceux qui recherchent les vives impressions de l'âme. La vallée est, en effet, remarquable par sa belle végétation et par son ombre mystérieuse. Deux petites rivières y forment leur jonction et marient leurs eaux murmurantes qui s'enfuient bien loin en grondant vers la Selune. Un vieux pont en bois jeté en travers relie les deux rives et conduit à une prairie émaillée de mille fleurs agrestes à peu près inconnues ailleurs que dans les sentiers peu fréquentés des Alpes. Enfin, à l'extrémité de cette prairie que bordent deux rangs de rochers gigantesques ouverts comme les feuillets d'un éventail immense, se trouve enserré le coin le plus sauvage de cette contrée si renommée par ses tableaux ravissants de fraîcheur qui l'ont fait souvent appeler la Suisse de la Normandie.
La rivière, après avoir descendu du Pas-au-Diable, et roulé de chute en chute, se tordant en nombreux méandres, sur les marches d'un gigantesque escalier naturel taillé dans un roc élevé de près de deux cents pieds, comprimée par les pieds vigoureux du rocher, se précipite d'un bond dans une colonne blanchissante d'écume et vient se briser au milieu d'éclaboussures sur une table de pierre dont les bords se dérobent sous les rameaux touffus des lierres. Elle y arrive bouillonnante et les échos répètent avec fracas le grondement perpétuel et étourdissant de la trombe d'eau qui tourbillonne longtemps dans le bassin de la vallée.

Notre légende dit que ce lieu fut témoin, il y a plusieurs siècles, d'un événement dramatique. Elle emprunte ses personnages au temps des croisades et nous dit que l'un des plus puissants seigneurs du voisinage, déjà au déclin de la vie, partit un jour pour Jérusalem après avoir confié sa fille, jeune et charmante enfant, à l'un de ses écuyers, vieux et cruel. «Frappe sans crainte et punis le parjure, lui avait-il dit, en lui ouvrant la main, si jamais Blanche vient à trahir l'honneur avant mon retour ! Veille sur elle, puisqu'elle n'a plus de mère ! » Et le geôlier avait répondu : « Maître, je vous le jure ! »
Mais les doux regards d'un jeune page eurent bientôt le talent de charmer le coeur de la triste châtelaine délaissée par son unique appui pour les lointains voyages. Longtemps Blanche et Alfred n'osèrent échanger aucune parole. Leur mutuel amour resta pendant des mois un mystère pour chacun d'eux. Celle-là n'osait se défier d'un tout jeune adolescent , beau comme elle et qui avait grandi sous les yeux d'une noble mère ; celui-ci croyait rêver du bonheur des anges et ne pouvait croire qu'aimer ainsi d'un sentiment pur et sans mélange ne fût pas autorisé de Dieu. Chaque jour ils se revoyaient avec joie et leurs derniers regards se disaient : A demain. Le temps s'écoulait en vain; leur amour printanier restait frais comme au matin où il était éclos.
L'âge d'Alfred enlevait d'ailleurs toute défiance, aussi fut-il autorisé à faire de longues promenades avec la jeune châtelaine, tantôt à pied lui offrant son bras, tantôt montés côte à côte sur de lents coursiers. Fréquemment encore ils s'égarèrent sur les bords de la rivière, dans les bois et sur les sommets des collines. Ils recherchaient surtout de préférence la cascade et ses abords solitaires. Bien souvent ils y vinrent parler du passé et se dire leurs espérances dans l'avenir. Le retour du croisé était vivement désiré d'eux : ensemble quelquefois ils priaient pour qu'il fût prochain et que leur père ratifiât des serments renouvelés vingt fois dans une heure.
Un jour, comme de jeunes enfants qu'ils étaient, assis sur la mousse, la main dans la main, coeur contre coeur, et les yeux dans les yeux, ils se dirent bien bas un mot qu'ils n'osèrent achever. Puis, les doux aveux succédèrent aux doux aveux. Le présent était enchanteur pour ces jeunes âmes à peine écloses à l'existence. Ils semblaient oublier les plus simples précautions de la prudence. Leurs soupirs, croyaient-ils, étaient étouffés par le murmure du torrent dont les flots blanchis expiraient à leurs pieds.
Soudain le vieil écuyer, que ses instincts jaloux avaient averti de la secrète flamme du jeune page et de la candide châtelaine, apparut derrière eux, au milieu des branchages des bosquets. La voix des eaux avait empêché le bruit des pas du geôlier de parvenir jusqu'à leurs oreilles.
Son bras est levé. Il va frapper ses deux victimes de son épée, et leur sang va se confondre pour punir leur forfait, lorsque le génie de ces lieux écartant le glaive meurtrier avec sa baguette, change à l'instant les deux amants en corbeaux.
Depuis cette époque, ils sont toujours ensemble. Le lierre les abrite. Rarement on les voit, mais on les entend souvent se livrer à leurs ébats joyeux. Un même nid, dit-on, les rassemble, et jamais des yeux indiscrets ne les ont obligés de le déplacer.
On prétend cependant que chaque nuit leur forme première leur est rendue et que se promenant le long des rochers et dans les vallons, depuis longtemps ils ne redoutent plus les gardiens. Durant des siècles, leur bon génie n'a cessé de veiller sur eux un seul instant et il veille toujours sur leur bonheur éternel. Aussi, lorsque vous visiterez la cascade abandonnée et solitaire, si parfois vous entendez soupirer dans le lierre, ne fuyez pas, restez, car dans ce frais et gracieux sanctuaire, les soupirs qu'on entend sont des soupirs d'amour.
[1055353]
titevero (FR1) [None]
:: March 24, 2013, 3:04 p.m.
La grotte des nains
+de+fetes+072.jpg)

Sur les contreforts du Jura, à proximité de Ferrette, dans une gorge étroite et profonde, se trouve l'entrée d'une petite grotte. Nous sommes ici en face d'une des entrées du monde souterrain, celui habité par les nains.
Il y a fort longtemps vivait ici le peuple des nains. Ils vivaient éternellement jeunes avec un très joli visage et de beaux yeux. Visiblement ils étaient très riche, car ils se montraient toujours très bien vêtus. Tous leurs instruments et outils étaient en argent du plus fin. Ces nains se plaisaient à faire du bien à tous les gens de la contrée. A l'époque de la fenaison et des vendanges, ils quittaient leur monde souterrain et venaient aider les villageois. Ils n'acceptaient aucun paiement pour leur besogne et profitaient de toutes les occasions pour offrir aux humains de magnifiques présents. Ils soignaient les malades, consolaient les infirmes, s'occupaient des enfants, etc. Les paysans les invitaient à toutes les fêtes. Une chose pourtant intriguait les humains, surtout les commères : hiver comme été, quelle que soit la tâche accomplie, partout et tout le temps, les nains portaient de longues robes allant jusqu'au sol et cachant leurs pieds. Un jour, des jeunes filles, ne maîtrisant plus leur curiosité, décidèrent d'en avoir le coeur net. Par une nuit sans lune, elles allèrent étendre devant l'entrée de la grotte, une couche de sable fin ou de cendre ( les versions de la légende diffèrent sur ce point ). Elles se cachèrent en attendant le lever du jour. Dès le départ des nains, elles se précipitèrent vers leur piège et découvrirent le secret des nains. Le sol était couvert de traces de pattes palmées comme celles des oies ou des canards. Elles en rirent si fort que les nains les entendirent. Comprenant la ruse et la moquerie dont ils faisaient les frais, ils entrèrent tristement dans leur monde souterrain et en fermèrent à tout jamais la porte. Plus personne ne les vit et les humains, depuis ce jour, sont seuls pour effectuer leurs tâches.
La grotte des nains se trouve dans la "gorge aux loups" ( Wolfsgrube en Alsacien ) appelée également "Erdwibelschlucht" ( la gorge des petites femmes de la terre ). La grotte en elle-même est constituée d'un étroit boyau d'une vingtaine de mètres de longueur.
 La gorge des loups
La gorge des loups
Un mètre après l'entrée, le boyau se divise en deux branches. La branche de gauche prend un léger angle montant et celle de droite descend. La gorge est surplombée par le plateau des nains ou "Erdwibelefelsen" ( rocher des petites femmes de la terre ). Du belvédère situé sur ce rocher, on bénéficie d'une belle vue sur le village de Bouxwiller et la campagne environnante.
Ce plateau se prolonge du côté Ouest par le plateau de la "Heidenfluh", qui se termine par une falaise de quinze à vingt mètres de hauteur. Des radiesthésistes estiment que ce lieu servit à des cultes païens. Ils datent même ce culte vers 1375 av J.-C. Le nom de "Heidenfluh" signifierait le rocher des païens. De cet endroit, la vue sur le château de Ferrette est magnifique.
 Le château de Ferrette vue de la Heidenfluh
Le château de Ferrette vue de la Heidenfluh
+de+fetes+072.jpg)

Sur les contreforts du Jura, à proximité de Ferrette, dans une gorge étroite et profonde, se trouve l'entrée d'une petite grotte. Nous sommes ici en face d'une des entrées du monde souterrain, celui habité par les nains.
Il y a fort longtemps vivait ici le peuple des nains. Ils vivaient éternellement jeunes avec un très joli visage et de beaux yeux. Visiblement ils étaient très riche, car ils se montraient toujours très bien vêtus. Tous leurs instruments et outils étaient en argent du plus fin. Ces nains se plaisaient à faire du bien à tous les gens de la contrée. A l'époque de la fenaison et des vendanges, ils quittaient leur monde souterrain et venaient aider les villageois. Ils n'acceptaient aucun paiement pour leur besogne et profitaient de toutes les occasions pour offrir aux humains de magnifiques présents. Ils soignaient les malades, consolaient les infirmes, s'occupaient des enfants, etc. Les paysans les invitaient à toutes les fêtes. Une chose pourtant intriguait les humains, surtout les commères : hiver comme été, quelle que soit la tâche accomplie, partout et tout le temps, les nains portaient de longues robes allant jusqu'au sol et cachant leurs pieds. Un jour, des jeunes filles, ne maîtrisant plus leur curiosité, décidèrent d'en avoir le coeur net. Par une nuit sans lune, elles allèrent étendre devant l'entrée de la grotte, une couche de sable fin ou de cendre ( les versions de la légende diffèrent sur ce point ). Elles se cachèrent en attendant le lever du jour. Dès le départ des nains, elles se précipitèrent vers leur piège et découvrirent le secret des nains. Le sol était couvert de traces de pattes palmées comme celles des oies ou des canards. Elles en rirent si fort que les nains les entendirent. Comprenant la ruse et la moquerie dont ils faisaient les frais, ils entrèrent tristement dans leur monde souterrain et en fermèrent à tout jamais la porte. Plus personne ne les vit et les humains, depuis ce jour, sont seuls pour effectuer leurs tâches.
La grotte des nains se trouve dans la "gorge aux loups" ( Wolfsgrube en Alsacien ) appelée également "Erdwibelschlucht" ( la gorge des petites femmes de la terre ). La grotte en elle-même est constituée d'un étroit boyau d'une vingtaine de mètres de longueur.
 La gorge des loups
La gorge des loups Un mètre après l'entrée, le boyau se divise en deux branches. La branche de gauche prend un léger angle montant et celle de droite descend. La gorge est surplombée par le plateau des nains ou "Erdwibelefelsen" ( rocher des petites femmes de la terre ). Du belvédère situé sur ce rocher, on bénéficie d'une belle vue sur le village de Bouxwiller et la campagne environnante.
Ce plateau se prolonge du côté Ouest par le plateau de la "Heidenfluh", qui se termine par une falaise de quinze à vingt mètres de hauteur. Des radiesthésistes estiment que ce lieu servit à des cultes païens. Ils datent même ce culte vers 1375 av J.-C. Le nom de "Heidenfluh" signifierait le rocher des païens. De cet endroit, la vue sur le château de Ferrette est magnifique.
 Le château de Ferrette vue de la Heidenfluh
Le château de Ferrette vue de la Heidenfluh [1055357]
titevero (FR1) [None]
:: March 24, 2013, 3:47 p.m.
Le trésor de la Tour de Salleboeuf - Salleboeuf (32767)

Dans les souterrains situés sous les murs du castel, se trouveraient amassées des quantités immenses de sous d'or, dont, malgré de nombreuses tentatives, les habitants de Salleboeuf n'ont pu encore s'emparer.
Au-dessus du réduit où sont renfermées ces richesses, on voit, dit-on, une crevasse qui en indique à-peu-près l'emplacement.
On raconte qu'un jour, un paysan, armé d'une perche ou d'une longue branche d'arbre, parvint à la faire pénétrer par cette ouverture, et put toucher le trésor; mais le contact du bois avec le métal avait à peine eu le temps de se produire, que le paysan sentit une force surnaturelle se saisir de la perche et l'attirer vers le souterrain. -” L'imprudent investigateur, entraîné par la branche, allait disparaître avec elle dans l'excavation ; il lui fallut donc, bien qu'à regret, lâcher prise et perdre tout espoir de tenir jamais ces belles pièces d'or qu'il avait cru un instant avoir en sa possession.
Saint-Georges - Châtillon-en-Vendelais (35210)

On raconte a Châtillon-en-Vendelais, que, il y a bien longtemps, un pieux laboureur voulant débarrasser les pierres, dites la Roche-Aride, des sorciers et des sorcières qui les hantaient s'était mis en prières sous un hêtre, au lieu appelé depuis Saint-Georges, et là suppliait ce grand et valeureux saint de venir avec son armée purger le pays des malins esprits qui le désolaient.
Saint Georges, à la fin se laissa toucher et vint à la tête d'une légion de cavaliers, livrer un assaut aux suppôts du diable, qui furent battus et mis en déroute.
La mêlée avait été si longue, et si rude, que les chevaux de la légion de saint Georges tarirent, tellement ils étaient altérés, une source qui coulait au pied de la Roche-Aride.
Puis saint Georges et ses glorieux compagnons, avant de retourner au Paradis, vinrent se reposer à l'ombre du hêtre sous lequel priait le laboureur.
Ce serait en mémoire du passage du saint guerrier et pour le remercier de sa puissante intervention, qu'une chapelle aurait été érigée et placée sous son vocable dans l'emplacement même du hêtre.

Dans les souterrains situés sous les murs du castel, se trouveraient amassées des quantités immenses de sous d'or, dont, malgré de nombreuses tentatives, les habitants de Salleboeuf n'ont pu encore s'emparer.
Au-dessus du réduit où sont renfermées ces richesses, on voit, dit-on, une crevasse qui en indique à-peu-près l'emplacement.
On raconte qu'un jour, un paysan, armé d'une perche ou d'une longue branche d'arbre, parvint à la faire pénétrer par cette ouverture, et put toucher le trésor; mais le contact du bois avec le métal avait à peine eu le temps de se produire, que le paysan sentit une force surnaturelle se saisir de la perche et l'attirer vers le souterrain. -” L'imprudent investigateur, entraîné par la branche, allait disparaître avec elle dans l'excavation ; il lui fallut donc, bien qu'à regret, lâcher prise et perdre tout espoir de tenir jamais ces belles pièces d'or qu'il avait cru un instant avoir en sa possession.
Saint-Georges - Châtillon-en-Vendelais (35210)

On raconte a Châtillon-en-Vendelais, que, il y a bien longtemps, un pieux laboureur voulant débarrasser les pierres, dites la Roche-Aride, des sorciers et des sorcières qui les hantaient s'était mis en prières sous un hêtre, au lieu appelé depuis Saint-Georges, et là suppliait ce grand et valeureux saint de venir avec son armée purger le pays des malins esprits qui le désolaient.
Saint Georges, à la fin se laissa toucher et vint à la tête d'une légion de cavaliers, livrer un assaut aux suppôts du diable, qui furent battus et mis en déroute.
La mêlée avait été si longue, et si rude, que les chevaux de la légion de saint Georges tarirent, tellement ils étaient altérés, une source qui coulait au pied de la Roche-Aride.
Puis saint Georges et ses glorieux compagnons, avant de retourner au Paradis, vinrent se reposer à l'ombre du hêtre sous lequel priait le laboureur.
Ce serait en mémoire du passage du saint guerrier et pour le remercier de sa puissante intervention, qu'une chapelle aurait été érigée et placée sous son vocable dans l'emplacement même du hêtre.
[1055360]
titevero (FR1) [None]
:: March 24, 2013, 4:54 p.m.
Légende des Saladins d’Anglure (Aube)
Anglure est le nom d’un village et d’un château situés à l’angle d’une île, sur l’Aube, à quelque distance de Troyes, sur les limites du département de la Marne. Suivant la tradition, les sires d’Anglure s’appelaient primitivement Saint-Chéron, et portaient pour armes une croix ancrée de sable sur un champ d’argent.
Mais il arriva qu’un gentilhomme de cette famille partit pour la croisade et se battit contre les infidèles. Vaincu et fait prisonnier par Saladin, il fut chargé de fers et réduit au sort des esclaves. Cependant le vainqueur, frappé de la bravoure qu’il avait déployée dans la bataille, lui promit sa liberté, moyennant une forte rançon, et lui accorda la liberté d’aller la chercher lui-même, pourvu qu’il laissât au départ un gage de sa fidélité. Je suis pauvre et nu dit le gentilhomme ; mais je t’engage un trésor qui me reste, plus précieux cent fois que toutes les richesses du monde, ma foi de chevalier. Saladin le laissa partir.
Le seigneur d’Anglure arrive à la porte de son manoir, défiguré par les souffrances de la captivité, par les fatigues du voyage, par sa longue barbe et son habit de pèlerin. Ses serviteurs le prennent pour un étranger, et ne cèdent qu’avec peine à ses instances pour lui livrer l’entrée. Il trouve sa jeune épouse qui, se croyant veuve, célébrait ce jour même les fiançailles d’une nouvelle union. A l’aide d’un anneau rompu dont chacun des époux avait conservé une moitié le mari parvient à se faire reconnaître, et les préparatifs d’allégresse servent à fêter son retour inattendu.
Jean d’Anglure, c’est le nom que lui donne la légende, goûtait depuis quelque temps les douceurs de la famille. Mais tous ses efforts n’avaient pu réussir à rassembler la somme à laquelle avait été fixée sa rançon. Cependant le délai expire ; le chevalier songe à sa parole engagée, il s’arrache à son bonheur et retourne en captivité. Le sultan touché de tant de noblesse, ne voulut pas se laisser vaincre en générosité. Il combla le chrétien de présents et le renvoya libre, mais à deux conditions : la première, que les aînés de sa maison s’appelleraient Saladin ; la seconde, qu’il prendrait désormais pour armes des grelots soutenus de croissants, symbole oriental.
Certains généalogistes racontent différemment cette aventure. Selon eux, un seigneur d’Anglure ayant vaincu un mécréant du nom de Saladin, les chrétiens l’engagèrent à transmettre à ses aînés ce nom, comme un souvenir impérissable de son exploit. Quant aux armes, ils prétendent que de tout temps elles se composèrent de grelots accompagnés d’anglures ou découpures en angles, ce qui formait des armoiries parlantes.
Quoi qu’il en soit, tant que la maison d’Anglure subsista, le prénom de Saladin fut de siècle en siècle porté dans cette famille. Devenus propriétaires du château de Jours en Bourgogne de Bourlemont en Lorraine, d’Estoges en Champagne, etc., les Saladins d’Anglure conservèrent partout cette tradition et la firent représenter à l’aide de la peinture et du ciseau dans ces diverses résidences. A Jours, on montrait encore, avant la révolution, deux figures de plomb posées en jaquemart, et qui dominaient la toiture du château : l’une était appelée Saladin, et l’autre le chevalier d’Anglure. Le Musée archéologique de Dijon conserve un retable sculpté, provenant de ce manoir remarquable, entièrement construit dans le goût de la renaissance. Enfin le château de Bourlemont possède dans sa chapelle plusieurs tombes gravées, où sont figurés des seigneurs de la maison d’Anglure couchés, les mains jointes, vêtus en guerre et armés de leurs blasons.
Apparition du Navire des Morts sur la jetée de Dieppe le 2 novembre
D’après une légende très accréditée en Normandie, un bruit sinistre se fait entendre pendant la nuit de la Toussaint, du 1er au 2 novembre, à la pointe de la jetée de Dieppe. Une tourmente se lève sur la mer, et du milieu des vagues le Navire des Morts paraît, ainsi appelé parce que sont à bord les trépassés de l’année. Se promenant longtemps sur les flots dans le silence et dans les ténèbres de la nuit, il s’y abîme ensuite aux sons d’un chœur chanté par les morts, sur l’air du Dies irae.
e jour des Morts est pour les marins une grande solennité ; ce jour leur rappelle tous les naufrages de l’année : ils prient avec ferveur pour ceux qui reposent au fond des flots. Toutefois, parmi les victimes, il en est toujours un certain nombre que leurs parents ou leurs amis ont négligées, qui attendent des messes, des prières, et ont un compte à régler avec les vivants ; de là l’histoire qu’on vous raconte à Dieppe.

Presque chaque année, le jour des Morts, on voit apparaître au bout de la jetée un des navires qui ont péri depuis un an ; on le reconnaît : ce font ses voiles, ses cordages, sa mâture ; c’est bien lui. Le gardien du phare lui jette la drome, l’équipage du vaisseau la saisit, et l’attache à l’avant-pont, suivant l’usage ; alors le gardien de crier aux gens du port : « Accourez , accourez ! Veuves, voici vos maris ; orphelins, voici vos pères ! » Et les femmes accourent, suivies de leurs enfants ; tous s’attellent à la drome et halent le bateau. Bientôt il est dans le bassin, près du quai ; chacun reconnaît ceux qui sont à bord. « Bonjour, mon homme ; bonjour, mon père ; bonjour, Pierre, Nicolas, Grégoire ; » l’équipage ne répond pas. « Allons, amenez vos voiles » ; les voiles restent tendues. « Venez donc, que nous vous embrassions. » A ces mots on entend sonner la messe, et aussitôt les voiles, le bateau, l’équipage, tout disparaît ; les femmes et les enfants des naufragés s’en vont à l’église en pleurant. « Payez vos dettes », murmure autour d’eux la foule des spectateurs.
Cette légende est quelquefois contée d’une autre manière. Les Polletais disent que le jour des Morts, à la nuit tombante, il arrive parfois qu’on voit s’approcher du bout de la jetée du Pollet un bateau que l’on prendrait pour un bateau du port. Le maître haleur, trompé par l’apparence, s’apprête à jeter la drome ; mais, lorsqu’il étend les bras, la figure du bateau s’évanouit, et l’on entend par les airs des voix plaintives : ce sont celles des hommes du Pollet qui, dans le cours de l’année, sont morts à la mer, loin des yeux de leurs parents, et sans sépulture.
Un marin qui oublie les vœux et les promesses qu’il fait aux saints pendant la tempête, ne trouve jamais dans l’autre monde ni trêve ni repos. Si vous en doutez , sachez ce qu’il advint, il y a quelques siècles, au bedeau de Notre-Dame-des-Grèves, l’église du Pollet. Le lendemain d’une grande tempête, vers minuit, le bedeau entend sonner la messe ; il saute à bas du lit, se frotte les yeux, prête l’oreille ; c’est bien la cloche de l’église. « Est-il déjà jour ? » Il ouvre sa lucarne ; la lune, cachée derrière les nuages, répandait une faible clarté. « Le soleil va se lever, dit-il ; j’ai donc bien sommeillé ? » Et le voilà qui endosse sa casaque et descend à l’église. La porte est ouverte ; un prêtre est au pied de l’autel. « Sers-moi la messe », lui dit le prêtre ; et le pauvre bedeau prend les burettes en tremblant.
Mais quand vient le moment du sacrifice, quand le prêtre va pour porter le calice à ses lèvres, il pousse un cri, sa chasuble tombe ; il n’est plus qu’un squelette. « Maître Pierre, dit-il au bedeau, mon pauvre Pierre, tu ne reconnais pas Reynaud, dont le bateau a péri le lundi de Pâques sur la roche d’Ailly ? J’avais fais vœu d’une messe à Notre-Dame, et j’ai oublié mon vœu. Je voudrais, pour m’acquitter, la dire moi-même, cette messe ! mais quand je vais pour communier, tout l’enfer passe par ma gorge ; je brûle, maître Pierre ! Dites à mon fils de ne pas oublier les messes qu’il aura promises à Notre-Dame. » Selon d’autres récits, le squelette n’est pas celui d’un maître de bateau, mais bien celui d’un prêtre. Dans ce cas, la légende est une leçon populaire donnée au clergé lui-même.
Au contraire, quand le bateau a été bien baptisé, qu’il a de bons parrains, que tous les matelots ont fait leurs Pâques ; quand ils ont à bord de l’eau bénite et des crucifix, alors survienne un orage, vous voyez au fort de la tempête l’équipage se doubler tout à coup. Vous étiez six matelots, vous voilà douze : chacun a son sosie qui travaille à côté de lui. Aussi comme la manœuvre est rapide ! comme le vaisseau triomphe du vent et de la vague ! c’est le saint son patron et quelques saints ses amis qui sont descendus pour le sauver.
En 1848, Mme de Saint-George présente au concours de l’Académie des Jeux Floraux une ballade intitulée Le Navire des Morts se rapportant à la légende de Dieppe pendant la nuit de Toussaint. Erigée en Académie en 1694, Louis XIV en ayant édicté les statuts, l’Académie des Jeux Floraux est considérée comme la plus ancienne société savante d’Europe, connue dès le XVIe siècle sous le nom de Compagnie des Jeux Floraux, nouvelle dénomination du Consistoire du Gai Savoir créé en 1323 par plusieurs poètes et concours littéraire en langue d’oc récompensant chaque année un troubadour d’une violette dorée à l’or fin, dont la première édition eut lieu le 3 mai 1324.
 Le Vaisseau Fantôme, par Charles Meryon
Le Vaisseau Fantôme, par Charles Meryon
Coq pour ruiner l’oeuvre du diable
Une légende prétend qu’un meunier corse accepta une main tendue par le diable, lequel lui proposa de jeter un pont en pierres pour s’affranchir des crues récurrentes emportant une passerelle indispensable à notre homme.
En Corse, du temps de la domination génoise, il y avait sur les rives du Golo, non loin du village de Castirlo, un moulin à farine qui desservait toute la vallée. Pour communiquer d’une rive à l’autre, on traversait la rivière à gué ou sur une passerelle mobile et des plus primitives. Il arrivait souvent que le passage était intercepté et la passerelle emportée par les crues. Ces accidents contrariaient particulièrement le meunier qui, privé de communications, se trouvait dans la nécessité de faire chômer son moulin. Un jour, à la tombée de la nuit, au moment où il allait passer la rivière avec son âne chargé de farine, une forte crue survint subitement.
Le meunier dans cet embarras se lamentait en lançant des imprécations : un étranger apparut, qui lui demanda pourquoi il était en si grande colère. Le meunier ne lui en cacha pas la cause et l’étranger lui promit que s’il voulait lui livrer son âme, il s’engageait à jeter un pont en pierres sur le torrent avant minuit sonnant. Le meunier accepta cette proposition inespérée et avantageuse. Peu d’instants après, la rivière était le centre d’un horrible mouvement, l’oeuvre commencée se poursuivait avec une activité diabolique et tout faisait prévoir que la promesse de l’inconnu serait réalisée.
Le meunier, qui n’avait pas tout d’abord réfléchi aux conséquences du contrat, devint perplexe. Cet inconnu pouvait être Lucifer et il lui avait livré son âme. Son angoisse allait grandissant avec l’avancement des travaux. Elle fut à son comble quand il vit que les trois voûtes étaient fermées et que l’on commençait à maçonner les tympans. L’ouvrage ne pouvait tarder à être achevé et minuit était encore loin. Une idée lui vint. Sans plus attendre une seconde, il alla réveiller le curé du village et lui raconta le pacte qu’il avait conclu. Après quelques instants de réflexion, le curé lui dit : « As-tu un coq parmi tes poules ? » Et sur sa réponse affirmative, il ajouta : « Va vite, remplis une cruche d’eau, et jette-en une partie sur lui : en sentant la fraîcheur de l’eau, le coq battra des ailes et chantera. Pars, et si tu arrives avant l’heure convenue, tu es sauvé. »
Le meunier se hâta de suivre le conseil du curé, et avant minuit le coq chanta. Il ne restait plus que les parapets à construire. Un épouvantable fracas suivit le chant du coq et fut répété les échos de la vallée. Avant que le pont ne fût restauré et élargi pour l’usage de la route forestière numéro 9 qui l’a emprunté, on découvrait sur la chaussée une large pierre portant l’empreinte d’un pied fourchu. Une autre légende raconte qu’en Corse, un coq blanc, que réveille le bon ange de saint Martin, pousse un cocorico strident et met en fuite le diable au moment même où il allait poser la dernière pierre d’un pont.
Anglure est le nom d’un village et d’un château situés à l’angle d’une île, sur l’Aube, à quelque distance de Troyes, sur les limites du département de la Marne. Suivant la tradition, les sires d’Anglure s’appelaient primitivement Saint-Chéron, et portaient pour armes une croix ancrée de sable sur un champ d’argent.
Mais il arriva qu’un gentilhomme de cette famille partit pour la croisade et se battit contre les infidèles. Vaincu et fait prisonnier par Saladin, il fut chargé de fers et réduit au sort des esclaves. Cependant le vainqueur, frappé de la bravoure qu’il avait déployée dans la bataille, lui promit sa liberté, moyennant une forte rançon, et lui accorda la liberté d’aller la chercher lui-même, pourvu qu’il laissât au départ un gage de sa fidélité. Je suis pauvre et nu dit le gentilhomme ; mais je t’engage un trésor qui me reste, plus précieux cent fois que toutes les richesses du monde, ma foi de chevalier. Saladin le laissa partir.
Le seigneur d’Anglure arrive à la porte de son manoir, défiguré par les souffrances de la captivité, par les fatigues du voyage, par sa longue barbe et son habit de pèlerin. Ses serviteurs le prennent pour un étranger, et ne cèdent qu’avec peine à ses instances pour lui livrer l’entrée. Il trouve sa jeune épouse qui, se croyant veuve, célébrait ce jour même les fiançailles d’une nouvelle union. A l’aide d’un anneau rompu dont chacun des époux avait conservé une moitié le mari parvient à se faire reconnaître, et les préparatifs d’allégresse servent à fêter son retour inattendu.
Jean d’Anglure, c’est le nom que lui donne la légende, goûtait depuis quelque temps les douceurs de la famille. Mais tous ses efforts n’avaient pu réussir à rassembler la somme à laquelle avait été fixée sa rançon. Cependant le délai expire ; le chevalier songe à sa parole engagée, il s’arrache à son bonheur et retourne en captivité. Le sultan touché de tant de noblesse, ne voulut pas se laisser vaincre en générosité. Il combla le chrétien de présents et le renvoya libre, mais à deux conditions : la première, que les aînés de sa maison s’appelleraient Saladin ; la seconde, qu’il prendrait désormais pour armes des grelots soutenus de croissants, symbole oriental.
Certains généalogistes racontent différemment cette aventure. Selon eux, un seigneur d’Anglure ayant vaincu un mécréant du nom de Saladin, les chrétiens l’engagèrent à transmettre à ses aînés ce nom, comme un souvenir impérissable de son exploit. Quant aux armes, ils prétendent que de tout temps elles se composèrent de grelots accompagnés d’anglures ou découpures en angles, ce qui formait des armoiries parlantes.
Quoi qu’il en soit, tant que la maison d’Anglure subsista, le prénom de Saladin fut de siècle en siècle porté dans cette famille. Devenus propriétaires du château de Jours en Bourgogne de Bourlemont en Lorraine, d’Estoges en Champagne, etc., les Saladins d’Anglure conservèrent partout cette tradition et la firent représenter à l’aide de la peinture et du ciseau dans ces diverses résidences. A Jours, on montrait encore, avant la révolution, deux figures de plomb posées en jaquemart, et qui dominaient la toiture du château : l’une était appelée Saladin, et l’autre le chevalier d’Anglure. Le Musée archéologique de Dijon conserve un retable sculpté, provenant de ce manoir remarquable, entièrement construit dans le goût de la renaissance. Enfin le château de Bourlemont possède dans sa chapelle plusieurs tombes gravées, où sont figurés des seigneurs de la maison d’Anglure couchés, les mains jointes, vêtus en guerre et armés de leurs blasons.
Apparition du Navire des Morts sur la jetée de Dieppe le 2 novembre
D’après une légende très accréditée en Normandie, un bruit sinistre se fait entendre pendant la nuit de la Toussaint, du 1er au 2 novembre, à la pointe de la jetée de Dieppe. Une tourmente se lève sur la mer, et du milieu des vagues le Navire des Morts paraît, ainsi appelé parce que sont à bord les trépassés de l’année. Se promenant longtemps sur les flots dans le silence et dans les ténèbres de la nuit, il s’y abîme ensuite aux sons d’un chœur chanté par les morts, sur l’air du Dies irae.
e jour des Morts est pour les marins une grande solennité ; ce jour leur rappelle tous les naufrages de l’année : ils prient avec ferveur pour ceux qui reposent au fond des flots. Toutefois, parmi les victimes, il en est toujours un certain nombre que leurs parents ou leurs amis ont négligées, qui attendent des messes, des prières, et ont un compte à régler avec les vivants ; de là l’histoire qu’on vous raconte à Dieppe.

Presque chaque année, le jour des Morts, on voit apparaître au bout de la jetée un des navires qui ont péri depuis un an ; on le reconnaît : ce font ses voiles, ses cordages, sa mâture ; c’est bien lui. Le gardien du phare lui jette la drome, l’équipage du vaisseau la saisit, et l’attache à l’avant-pont, suivant l’usage ; alors le gardien de crier aux gens du port : « Accourez , accourez ! Veuves, voici vos maris ; orphelins, voici vos pères ! » Et les femmes accourent, suivies de leurs enfants ; tous s’attellent à la drome et halent le bateau. Bientôt il est dans le bassin, près du quai ; chacun reconnaît ceux qui sont à bord. « Bonjour, mon homme ; bonjour, mon père ; bonjour, Pierre, Nicolas, Grégoire ; » l’équipage ne répond pas. « Allons, amenez vos voiles » ; les voiles restent tendues. « Venez donc, que nous vous embrassions. » A ces mots on entend sonner la messe, et aussitôt les voiles, le bateau, l’équipage, tout disparaît ; les femmes et les enfants des naufragés s’en vont à l’église en pleurant. « Payez vos dettes », murmure autour d’eux la foule des spectateurs.
Cette légende est quelquefois contée d’une autre manière. Les Polletais disent que le jour des Morts, à la nuit tombante, il arrive parfois qu’on voit s’approcher du bout de la jetée du Pollet un bateau que l’on prendrait pour un bateau du port. Le maître haleur, trompé par l’apparence, s’apprête à jeter la drome ; mais, lorsqu’il étend les bras, la figure du bateau s’évanouit, et l’on entend par les airs des voix plaintives : ce sont celles des hommes du Pollet qui, dans le cours de l’année, sont morts à la mer, loin des yeux de leurs parents, et sans sépulture.
Un marin qui oublie les vœux et les promesses qu’il fait aux saints pendant la tempête, ne trouve jamais dans l’autre monde ni trêve ni repos. Si vous en doutez , sachez ce qu’il advint, il y a quelques siècles, au bedeau de Notre-Dame-des-Grèves, l’église du Pollet. Le lendemain d’une grande tempête, vers minuit, le bedeau entend sonner la messe ; il saute à bas du lit, se frotte les yeux, prête l’oreille ; c’est bien la cloche de l’église. « Est-il déjà jour ? » Il ouvre sa lucarne ; la lune, cachée derrière les nuages, répandait une faible clarté. « Le soleil va se lever, dit-il ; j’ai donc bien sommeillé ? » Et le voilà qui endosse sa casaque et descend à l’église. La porte est ouverte ; un prêtre est au pied de l’autel. « Sers-moi la messe », lui dit le prêtre ; et le pauvre bedeau prend les burettes en tremblant.
Mais quand vient le moment du sacrifice, quand le prêtre va pour porter le calice à ses lèvres, il pousse un cri, sa chasuble tombe ; il n’est plus qu’un squelette. « Maître Pierre, dit-il au bedeau, mon pauvre Pierre, tu ne reconnais pas Reynaud, dont le bateau a péri le lundi de Pâques sur la roche d’Ailly ? J’avais fais vœu d’une messe à Notre-Dame, et j’ai oublié mon vœu. Je voudrais, pour m’acquitter, la dire moi-même, cette messe ! mais quand je vais pour communier, tout l’enfer passe par ma gorge ; je brûle, maître Pierre ! Dites à mon fils de ne pas oublier les messes qu’il aura promises à Notre-Dame. » Selon d’autres récits, le squelette n’est pas celui d’un maître de bateau, mais bien celui d’un prêtre. Dans ce cas, la légende est une leçon populaire donnée au clergé lui-même.
Au contraire, quand le bateau a été bien baptisé, qu’il a de bons parrains, que tous les matelots ont fait leurs Pâques ; quand ils ont à bord de l’eau bénite et des crucifix, alors survienne un orage, vous voyez au fort de la tempête l’équipage se doubler tout à coup. Vous étiez six matelots, vous voilà douze : chacun a son sosie qui travaille à côté de lui. Aussi comme la manœuvre est rapide ! comme le vaisseau triomphe du vent et de la vague ! c’est le saint son patron et quelques saints ses amis qui sont descendus pour le sauver.
En 1848, Mme de Saint-George présente au concours de l’Académie des Jeux Floraux une ballade intitulée Le Navire des Morts se rapportant à la légende de Dieppe pendant la nuit de Toussaint. Erigée en Académie en 1694, Louis XIV en ayant édicté les statuts, l’Académie des Jeux Floraux est considérée comme la plus ancienne société savante d’Europe, connue dès le XVIe siècle sous le nom de Compagnie des Jeux Floraux, nouvelle dénomination du Consistoire du Gai Savoir créé en 1323 par plusieurs poètes et concours littéraire en langue d’oc récompensant chaque année un troubadour d’une violette dorée à l’or fin, dont la première édition eut lieu le 3 mai 1324.
 Le Vaisseau Fantôme, par Charles Meryon
Le Vaisseau Fantôme, par Charles MeryonCoq pour ruiner l’oeuvre du diable
Une légende prétend qu’un meunier corse accepta une main tendue par le diable, lequel lui proposa de jeter un pont en pierres pour s’affranchir des crues récurrentes emportant une passerelle indispensable à notre homme.
En Corse, du temps de la domination génoise, il y avait sur les rives du Golo, non loin du village de Castirlo, un moulin à farine qui desservait toute la vallée. Pour communiquer d’une rive à l’autre, on traversait la rivière à gué ou sur une passerelle mobile et des plus primitives. Il arrivait souvent que le passage était intercepté et la passerelle emportée par les crues. Ces accidents contrariaient particulièrement le meunier qui, privé de communications, se trouvait dans la nécessité de faire chômer son moulin. Un jour, à la tombée de la nuit, au moment où il allait passer la rivière avec son âne chargé de farine, une forte crue survint subitement.
Le meunier dans cet embarras se lamentait en lançant des imprécations : un étranger apparut, qui lui demanda pourquoi il était en si grande colère. Le meunier ne lui en cacha pas la cause et l’étranger lui promit que s’il voulait lui livrer son âme, il s’engageait à jeter un pont en pierres sur le torrent avant minuit sonnant. Le meunier accepta cette proposition inespérée et avantageuse. Peu d’instants après, la rivière était le centre d’un horrible mouvement, l’oeuvre commencée se poursuivait avec une activité diabolique et tout faisait prévoir que la promesse de l’inconnu serait réalisée.
Le meunier, qui n’avait pas tout d’abord réfléchi aux conséquences du contrat, devint perplexe. Cet inconnu pouvait être Lucifer et il lui avait livré son âme. Son angoisse allait grandissant avec l’avancement des travaux. Elle fut à son comble quand il vit que les trois voûtes étaient fermées et que l’on commençait à maçonner les tympans. L’ouvrage ne pouvait tarder à être achevé et minuit était encore loin. Une idée lui vint. Sans plus attendre une seconde, il alla réveiller le curé du village et lui raconta le pacte qu’il avait conclu. Après quelques instants de réflexion, le curé lui dit : « As-tu un coq parmi tes poules ? » Et sur sa réponse affirmative, il ajouta : « Va vite, remplis une cruche d’eau, et jette-en une partie sur lui : en sentant la fraîcheur de l’eau, le coq battra des ailes et chantera. Pars, et si tu arrives avant l’heure convenue, tu es sauvé. »
Le meunier se hâta de suivre le conseil du curé, et avant minuit le coq chanta. Il ne restait plus que les parapets à construire. Un épouvantable fracas suivit le chant du coq et fut répété les échos de la vallée. Avant que le pont ne fût restauré et élargi pour l’usage de la route forestière numéro 9 qui l’a emprunté, on découvrait sur la chaussée une large pierre portant l’empreinte d’un pied fourchu. Une autre légende raconte qu’en Corse, un coq blanc, que réveille le bon ange de saint Martin, pousse un cocorico strident et met en fuite le diable au moment même où il allait poser la dernière pierre d’un pont.
[1055363]
titevero (FR1) [None]
:: March 24, 2013, 5:17 p.m.
Le Babau de Rivesaltes
C'est probablement une des légendes les plus connues des Roussillonnais. A tel point que les habitants de Rivesaltes sont régulièrement surnommés les «Babaus» ! Certes, il y a dans ce village des bords d'Agly, ce nectar des Dieux qu'est le muscat. Il y a encore cet équestre Maréchal Joffre qui trône sur les allées du centre-ville.
La légende du Babau
Tous les Roussillonnais ont entendu parler du BABAU (prononcé BABAOU) et ne se privent pas de menacer les enfants de la voracité de ce monstre légendaire. On sait ou il s'est manifeseté, à RIVESALTES, il y a bien longtemps, mais en général peu de gens en connaissent davantage.
Depuis quelques cinq cents ans, l'agglomération de Tura avec sa chapelle Saint-Martin, sur la rive gauche de l'Agly, trop sujette aux inondations a progressivement été abandonnée au profit de la rive droite ou une centaine de maisons se serrent à l'interieur d'une épaisse muraille de remparts qui, au Nord, dominent l'Agly, celle-ci renforçant la défense de la ville.
La rivière avait son moulin, la ville son four banal car peu de famille étaient assez fortunées pour avoir le leur. Ce four avait été aménagé dans l'épaisseur des murailles surmontant l'Agly percées en divers endroits de trous permettant l'évacuation des eaux (eaux pluviales et eaux ménagères) vers la rivière.
Mais tout à coté de ce four paroissial existait un trou bien plus grand que les autres. C'est par là qu'on jetait les cendres, les ordures, et même les bêtes crevées. En raison de son emplacement on l'appelait tout simplement : "EL FORAT DEL FORN", le trou du four...
C'était dans la nuit du 2 au 3 Février 1290, une nuit sans lune mais étoilée. Il gelait à pierre fendre, tout était calme dans la petite ville endormie. L'époque était paisible en Roussillon sous le règne du pacifique Roi Jaume II de Majorque. La population reposait à l'abri des remparts dont les portes avaient été fermées comme d'habitude.
Depuis des mois déja, il n'y avait plus de veilleurs aux tours, seul Fardoli le Sereno, ponctuel, parcourait à pas lent les rues étroites, se bornant de sa voix chantante à annoncer l'heure et le temps.
Il y avait bien un quart d'heure qu'à l'autre extrémité du bourg on l'avait entendu proclamer "son las tres i sereno", lorsque tout à coup, les voisins du four furent réveillés par un grand bruit, un bruit affreux de pierres projetées avec force comme si une maison s'était écroulée. Dans trois maisons même, on eut l'impression d'un tremblement de terre.
Bientôt il y eu quelques cris d'enfants étouffés, des pleurs et un grand hurlement rauque, puis, à nouveau, un tintamarre de pierres qui roulent, et soudain le silence, un silence de mort.
Et c'est alors que le quartier put mesurer l'ampleur du désastre. Au total six enfants avaient disparu, des tout petits, des bébés et les clameurs des pauvres parents éplorés achevèrent de réveiller le voisinage. On sonna le tocsin et bientôt, tout RIVESALTES fut sur place.
Quelqu'un,quelque chose, une bête énorme à n'en pas douter, était entré dans le "Forat Del Forn" agrandissant le trou au passage, avaitdans leur sommeil, arraché de leur berceau ou de leur petit lit les pauvres proies innocentes dont elle devait se repaitre une fois revenu dans son antre...
La consternation, la désolation se lisaient sur tous les visages. Le curé doyen renvoya à plus tard la procession de la Saint Blaise qui devait se dérouler juste le 3 Février et annonça pour le lendemain une cérémonie de prières à la mémoire des innocentes victimes du fléau inconnu.
Deux nuits encore la bête sévit et la peur fut à son comble. Le Batlle décida de rétablir aussitôt les veilleurs sur les sept tours défendant la ville. Tous les gardes étaient munis de lances, d'arbalètes, et avaient d'amples provisions de flèches, de pierres et d'huile bouillante.
La bête revint. Imaginez d'abord un gros bouillonement d'eau remontant d'aval en amont sur les eaux habituellement calmes de l'Agly, puis un bruit de piétinement sur la berge avec comme un fracas de cascade du à toute l'eau que le monstre soulevait en sortant de la rivière et qui retournait à son lit.
Tous furent unanimes à estimer sa longueur aux environs de 80 à 100 pams de la tête à la queu ; D'après leur description, l'allure générale l'apparentait à l'igouane préhistorique, mais avec une bien plus grosse tête. Avec des yeux ronds énormes, brillants et démoniaques comme ceux d'un chat, une mâchoire puissante, des dents redoutables, un coup long, un corps épais terminé par des doigts courbes et mobiles ornés de griffes impressionnantes, le tout recouvert d'écailles affreuses et dures sur lesquelles les flèches des veilleurs rebondissaient comme sur du roc.
Au batlle qui lui demandait la description de la bête qu'il avait vue, l'un des veilleurs de la tour la plus proche du trou et qui était devenu bègue de frayeur ne put qu'articuler "VAVAU" (prononcé BABAU) c'est-à-dire, il a... il a... Le mot fit fortune et , depuis, le monstre fut dénommé le BABAU.
C'est le seigneur des Fraisses et Périllos, GALDRIC TRENCAVENT qui devait tirer d'affaire les Rivesaltais. C'était un fort bel homme, de haute stature, puissamment musclé, chasseur intrépide, terreur des sangliers du voisinage ; il avait en outre un joli talent d'arbelétrier. Il se proposa, pour tuer le BABAU. Le batlle accepta avec joie et au cours d'une réunion mémorable à laquelle participait GALDRIC, deux consuls et les conseillers, on établit un plan minutieux. Dés la nuit suivante, il était mis à execution.
Le "Forat Del Forn" fut dégagé de ses pierres et un jeune porc attaché à une quarantaine de pams du trou comme appât.
La quatrième nuit le bouillonnement des eaux attira l'attention des veilleurs. GALDRIC, alerté, se plaça à bonne portée du pourceau et vaillamment, attendit.
Du bruit sur la grève, un frottement puissant contre les murs, et soudain la tête du monstre apparu jaillissant violemment du trou.
C'est au moment ou le BABAu se jetait sur le pourceau que GALDRIC, prompt comme l'éclair, lui décocha une flèche qui pénétra dans la gueule ouverte du monstre. Il ne fut pas pour autant tué mais de la tour proche les veilleurs le virent agiter la tête avec colère en tous sens pour essayer de se débarrasser du trait qui meurtrissait sa gorge.

A quelques temps de là, les Rivesaltais apprirent qu'une sorte de monstre bléssé était allé s'échouer près d'Ortolanes ou il était mort d'épuisement.
Une délégation fut envoyée sur place, sous la conduite du batlle. Il y avait le valeureux GALDRIC bien sur, et les mieux placés des veilleurs, ceux qui pourraient le mieux reconnaître l'adversaire des nuits d'épouvante.
Ils furent formels, c'était bien le BABAu, qui avait fini par succomber aux blessures infligées par ses ennemis.
Pour que tous les habitants gardent un souvenir du monstre qui les avait tant fait souffrir, la délégation ramena trois côtes du BABAU.
Un efut exposée à l'église Sainte-Marie, une autre à la chapelle Saint-André et la troisième constitua le trophée que la population reconnaissante offrit à GALDRIC TRENCAVENT au cours d'une fête mémorable qui débuta par un Te Deum Somennel chanté en église Sainte-Marie. On fit une procession d'actions de grâces, puis on dansa et fit ripailles, le BABAU était enfin mort.
De nos jours
Une seule des trois côtes du BABAU est parvenu jusqu'à nous, ce qui est déjà bien extraordinaire après tant de siècles de vicissitudes.
Elle est actuellement exposée à l'office d'animation et du Tourisme de RIVESALTES et les visiteurs peuvent l'admirer et évaluer ainsi, les imposantees dimensions du BABAU.
La Fête du Babau remet en scène les temps forts de ce conte médiéval en faisant revivre le Babau, monstre mi-iguane, mi-dragon qui franchit les remparts de la ville et dévora plusieurs enfants.
Dès 11 heures du matin en plein mois d'août, le Babau fait sa première apparition dans les rues de Rivesaltes, escorté par le géant Galdric Trencavent et sa femme Radegonda, suivi de jeunes cavaliers émérites, de chars représentant une catapulte et une forge. Au fil des heures, échassiers, jongleurs, cracheurs de feu et fanfares tonitruantes défilent et le cortège grossit.

En début de soirée, la musique se fait plus assourdissante, comme pour étouffer les cris du monstre dont la fin est proche. Il sera sacrifié dans un embrasement pyrotechnique dès la nuit tombée.
C'est probablement une des légendes les plus connues des Roussillonnais. A tel point que les habitants de Rivesaltes sont régulièrement surnommés les «Babaus» ! Certes, il y a dans ce village des bords d'Agly, ce nectar des Dieux qu'est le muscat. Il y a encore cet équestre Maréchal Joffre qui trône sur les allées du centre-ville.
La légende du Babau
Tous les Roussillonnais ont entendu parler du BABAU (prononcé BABAOU) et ne se privent pas de menacer les enfants de la voracité de ce monstre légendaire. On sait ou il s'est manifeseté, à RIVESALTES, il y a bien longtemps, mais en général peu de gens en connaissent davantage.
Depuis quelques cinq cents ans, l'agglomération de Tura avec sa chapelle Saint-Martin, sur la rive gauche de l'Agly, trop sujette aux inondations a progressivement été abandonnée au profit de la rive droite ou une centaine de maisons se serrent à l'interieur d'une épaisse muraille de remparts qui, au Nord, dominent l'Agly, celle-ci renforçant la défense de la ville.
La rivière avait son moulin, la ville son four banal car peu de famille étaient assez fortunées pour avoir le leur. Ce four avait été aménagé dans l'épaisseur des murailles surmontant l'Agly percées en divers endroits de trous permettant l'évacuation des eaux (eaux pluviales et eaux ménagères) vers la rivière.
Mais tout à coté de ce four paroissial existait un trou bien plus grand que les autres. C'est par là qu'on jetait les cendres, les ordures, et même les bêtes crevées. En raison de son emplacement on l'appelait tout simplement : "EL FORAT DEL FORN", le trou du four...
C'était dans la nuit du 2 au 3 Février 1290, une nuit sans lune mais étoilée. Il gelait à pierre fendre, tout était calme dans la petite ville endormie. L'époque était paisible en Roussillon sous le règne du pacifique Roi Jaume II de Majorque. La population reposait à l'abri des remparts dont les portes avaient été fermées comme d'habitude.
Depuis des mois déja, il n'y avait plus de veilleurs aux tours, seul Fardoli le Sereno, ponctuel, parcourait à pas lent les rues étroites, se bornant de sa voix chantante à annoncer l'heure et le temps.
Il y avait bien un quart d'heure qu'à l'autre extrémité du bourg on l'avait entendu proclamer "son las tres i sereno", lorsque tout à coup, les voisins du four furent réveillés par un grand bruit, un bruit affreux de pierres projetées avec force comme si une maison s'était écroulée. Dans trois maisons même, on eut l'impression d'un tremblement de terre.
Bientôt il y eu quelques cris d'enfants étouffés, des pleurs et un grand hurlement rauque, puis, à nouveau, un tintamarre de pierres qui roulent, et soudain le silence, un silence de mort.
Et c'est alors que le quartier put mesurer l'ampleur du désastre. Au total six enfants avaient disparu, des tout petits, des bébés et les clameurs des pauvres parents éplorés achevèrent de réveiller le voisinage. On sonna le tocsin et bientôt, tout RIVESALTES fut sur place.
Quelqu'un,quelque chose, une bête énorme à n'en pas douter, était entré dans le "Forat Del Forn" agrandissant le trou au passage, avaitdans leur sommeil, arraché de leur berceau ou de leur petit lit les pauvres proies innocentes dont elle devait se repaitre une fois revenu dans son antre...
La consternation, la désolation se lisaient sur tous les visages. Le curé doyen renvoya à plus tard la procession de la Saint Blaise qui devait se dérouler juste le 3 Février et annonça pour le lendemain une cérémonie de prières à la mémoire des innocentes victimes du fléau inconnu.
Deux nuits encore la bête sévit et la peur fut à son comble. Le Batlle décida de rétablir aussitôt les veilleurs sur les sept tours défendant la ville. Tous les gardes étaient munis de lances, d'arbalètes, et avaient d'amples provisions de flèches, de pierres et d'huile bouillante.
La bête revint. Imaginez d'abord un gros bouillonement d'eau remontant d'aval en amont sur les eaux habituellement calmes de l'Agly, puis un bruit de piétinement sur la berge avec comme un fracas de cascade du à toute l'eau que le monstre soulevait en sortant de la rivière et qui retournait à son lit.
Tous furent unanimes à estimer sa longueur aux environs de 80 à 100 pams de la tête à la queu ; D'après leur description, l'allure générale l'apparentait à l'igouane préhistorique, mais avec une bien plus grosse tête. Avec des yeux ronds énormes, brillants et démoniaques comme ceux d'un chat, une mâchoire puissante, des dents redoutables, un coup long, un corps épais terminé par des doigts courbes et mobiles ornés de griffes impressionnantes, le tout recouvert d'écailles affreuses et dures sur lesquelles les flèches des veilleurs rebondissaient comme sur du roc.
Au batlle qui lui demandait la description de la bête qu'il avait vue, l'un des veilleurs de la tour la plus proche du trou et qui était devenu bègue de frayeur ne put qu'articuler "VAVAU" (prononcé BABAU) c'est-à-dire, il a... il a... Le mot fit fortune et , depuis, le monstre fut dénommé le BABAU.
C'est le seigneur des Fraisses et Périllos, GALDRIC TRENCAVENT qui devait tirer d'affaire les Rivesaltais. C'était un fort bel homme, de haute stature, puissamment musclé, chasseur intrépide, terreur des sangliers du voisinage ; il avait en outre un joli talent d'arbelétrier. Il se proposa, pour tuer le BABAU. Le batlle accepta avec joie et au cours d'une réunion mémorable à laquelle participait GALDRIC, deux consuls et les conseillers, on établit un plan minutieux. Dés la nuit suivante, il était mis à execution.
Le "Forat Del Forn" fut dégagé de ses pierres et un jeune porc attaché à une quarantaine de pams du trou comme appât.
La quatrième nuit le bouillonnement des eaux attira l'attention des veilleurs. GALDRIC, alerté, se plaça à bonne portée du pourceau et vaillamment, attendit.
Du bruit sur la grève, un frottement puissant contre les murs, et soudain la tête du monstre apparu jaillissant violemment du trou.
C'est au moment ou le BABAu se jetait sur le pourceau que GALDRIC, prompt comme l'éclair, lui décocha une flèche qui pénétra dans la gueule ouverte du monstre. Il ne fut pas pour autant tué mais de la tour proche les veilleurs le virent agiter la tête avec colère en tous sens pour essayer de se débarrasser du trait qui meurtrissait sa gorge.

A quelques temps de là, les Rivesaltais apprirent qu'une sorte de monstre bléssé était allé s'échouer près d'Ortolanes ou il était mort d'épuisement.
Une délégation fut envoyée sur place, sous la conduite du batlle. Il y avait le valeureux GALDRIC bien sur, et les mieux placés des veilleurs, ceux qui pourraient le mieux reconnaître l'adversaire des nuits d'épouvante.
Ils furent formels, c'était bien le BABAu, qui avait fini par succomber aux blessures infligées par ses ennemis.
Pour que tous les habitants gardent un souvenir du monstre qui les avait tant fait souffrir, la délégation ramena trois côtes du BABAU.
Un efut exposée à l'église Sainte-Marie, une autre à la chapelle Saint-André et la troisième constitua le trophée que la population reconnaissante offrit à GALDRIC TRENCAVENT au cours d'une fête mémorable qui débuta par un Te Deum Somennel chanté en église Sainte-Marie. On fit une procession d'actions de grâces, puis on dansa et fit ripailles, le BABAU était enfin mort.
De nos jours
Une seule des trois côtes du BABAU est parvenu jusqu'à nous, ce qui est déjà bien extraordinaire après tant de siècles de vicissitudes.
Elle est actuellement exposée à l'office d'animation et du Tourisme de RIVESALTES et les visiteurs peuvent l'admirer et évaluer ainsi, les imposantees dimensions du BABAU.
La Fête du Babau remet en scène les temps forts de ce conte médiéval en faisant revivre le Babau, monstre mi-iguane, mi-dragon qui franchit les remparts de la ville et dévora plusieurs enfants.
Dès 11 heures du matin en plein mois d'août, le Babau fait sa première apparition dans les rues de Rivesaltes, escorté par le géant Galdric Trencavent et sa femme Radegonda, suivi de jeunes cavaliers émérites, de chars représentant une catapulte et une forge. Au fil des heures, échassiers, jongleurs, cracheurs de feu et fanfares tonitruantes défilent et le cortège grossit.

En début de soirée, la musique se fait plus assourdissante, comme pour étouffer les cris du monstre dont la fin est proche. Il sera sacrifié dans un embrasement pyrotechnique dès la nuit tombée.
[1055367]
titevero (FR1) [None]
:: March 24, 2013, 6:13 p.m.
La Fontaine hideuse de Beuvry, maudite depuis la veille de la Noël 1493

Si la route de Lille à Béthune fait un coude à l'extrémité nord du terroir de Sailly-la-Bourse, c'est, selon la légende, pour éviter la Fontaine hideuse, maudite depuis la veille de la Noël 1493 lorsqu'elle eût englouti un convoi de voyageurs dans ses profondeurs insondables. Pas un brin d'herbe ne poussa depuis, pas un poisson ne fendit ses eaux qui acquirent la réputation de glacer les cœurs...
La route de joignant Lille à Béthune partait autrefois du moulin de Bellenville, en serpentant à travers des mares et des fossés, droit au mont de Beuvry. Elle était, entre ces deux endroits, en bien mauvais état pendant la saison pluvieuse, parce que le terrain y est marécageux et tourbeux.
Les habitants de Vermelles, de Cambrin et d'Annequin se rendant au marché de Béthune, devaient alors y transporter leurs produits à dos de cheval ou à demi-chargement de voiture. Le coche qui y passait deux fois par mois, avait soin de prendre à La Bassée, au Cheval Rouge, deux bons chevaux de relais, et ses six chevaux flamands, aux jours pluvieux, avaient bien de la peine à franchir ce passage.
Or, en l'an 1493, la veille de Noël, une pluie fine et glaciale tombant toute la matinée, avait fondu la neige qui couvrait la terre depuis huit jours, et rendait cet endroit difficile et dangereux. A cause des fêtes de Noël, le coche était bondé de voyageurs. Deux chartreux, deux nonnes, et deux moines, emplissaient le coupé ; quatre bons marchands se serraient dans l'intérieur à côté de deux jeunes fiancés ; l'impériale regorgeait de bagages et de marchandises.
Le phaéton, trompé par la lueur vacillante d'un feu follet, quitta la route empierrée et la voiture s'embourba. Sous le fouet et les jurons du conducteur, les chevaux se cabraient, frémissaient, piaffaient, mais le coche ne bougeait pas. Les hommes descendirent et délibérèrent. Les moines et les chartreux prirent chacun une roue, leurs bras nerveux se tendirent, les jantes craquèrent ; le coche ne bougea pas davantage. Les marchands et les religieux firent un suprême effort, mais encore en vain. "Que le diable emporte tout, dit le cocher, hors de lui même !"
Quand les moines, les chartreux et les marchands voulurent rebrousser chemin, ils sentirent qu'ils s'enlisaient, que l'eau et la boue leur montaient jusqu'aux genoux. Les malheureux, désespérés, glacés d'effroi, s'enfonçaient toujours lentement, graduellement, fatalement. Déjà l'enlisement gagnait leur poitrine. "Salva nos Domine ", dit une voix. "Miserere mei", dirent les moines. Et des lèvres brûlantes des marchands sortaient les noms bénis de fils et d'épouses.
Quand, vers minuit, entre deux nuages, la lune apparut, on ne vit plus que l'impériale du coche et des bras s'agitant convulsivement au-dessus de l'abîme dans lequel les nonnes étaient descendues évanouies, et les fiancés endormis, rêvant à l'hyménée. La neige recommença à tomber pour couvrir les victimes d'un blanc linceul. Deux pêcheurs qui tendaient près de là leurs filets, assistèrent pétrifiés à cette scène lugubre ; ils coururent, revenus à eux-mêmes, conter l'aventure à Beuvry. La foule, venant de toute la contrée, ne vit au milieu du grand chemin vert, au lieu du sinistre, qu'une fontaine de plus de 200 pieds de tour, claire, bleue, ovale, semblable à l'œil immense d'un monstre souterrain guettant sa proie.
On voulut sonder la fontaine : tous les câbles de la contrée, bout à bout, n'en trouvèrent pas le fond. On voulut, pour leur donner la sépulture, pour leur dire les prières des morts, pour qu'un ami pût venir sur leurs tombes, arracher les victimes au gouffre béant ; mais l'abîme est sans fond, et, malgré tous les efforts, il n'a rendu ni un cadavre, ni un lambeau de froc. On l'appela "la Fontaine hideuse". Depuis ce jour lamentable, tous les ans, dans la nuit de Noël, de la onzième à la douzième heure, on entend sans cesse au fond de la Fontaine hideuse, claquer le fouet d'un postillon, et, les âmes pieuses voient dans une sorte de coche lumineux : Jésus dans la crèche, Joseph et Marie, l'âne, les bœufs, les bergers et, l'étoile.
Depuis quatre siècles, pas un brin d'herbe n'a poussé dans la fontaine, pas un poisson n'a fendu ses eaux, pas une goutte de son onde n'a été réchauffée par les feux des étés les plus brûlants. Tous les monts de la Savoie ne pourraient combler cet abîme ! Tout le foin de la Normandie y disparaîtrait en un clin d'œil, comme englouti par un monstre invisible !
Deux tourbiers sont perclus aujourd'hui pour s'être baignés dans la fontaine. Ils ne doivent la vie qu'à la précaution qu'ils avaient prise de s'être fait attacher par une corde à l'aide de laquelle on les retira du danger qu'ils couraient de disparaître aussi. Malheur à ceux qui se sont désaltérés à la Fontaine, ils n'ont jamais connu les joies de l'hymen, ou les ont oubliées s'ils les avaient éprouvées déjà : quelques gouttes de son eau glacent encore les plus férus d'amour.
Que de jouvenceaux prêts à aller à l'autel ont pris le chemin du cloître ou du monastère. Les abbayes de Gonnay et de Choques en comptèrent par certaines. Que d'amantes jalouses ont glacé, avec de l'eau de la fontaine, malicieusement, méchamment le cœur de leurs amants !
Le propriétaire actuel de l'ancienne abbaye de Choques – village situé à une demi-lieue de Béthune – a retrouvé on 1866 sous le taillis d'un bosquet formé sur les ruines des bâtiments de ce monastère, six pierres tombales en marbre blanc et en grès sculpté encore visibles aujourd'hui, de Francicus Pruvost, d'Andreas Dessain, de Ludovicus Gouillart, d'Elegicus de Baillencourt-Courcol, d'Ambroise Rattel et de Prosper Bonvalet, pieuse relique, morts dans cet asile de paix en odeur de sainteté, grâce à l'eau miraculeuse de la Fontaine hideuse, suivant l'épitaphe libellée en latin.
Depuis que cette source est là béante, la route de Lille à Béthune fait un coude à l'extrémité Nord du terroir de Sailly-la-Bourse, les voitures ne passent plus par Werquin pour se rendre à Béthune, et les roseaux, la ciguë aquatique croissent dans les mares du Grand Chemin Vert qui partait, avant la Fontaine hideuse, d'Annequin au mont de Beuvry.

Si la route de Lille à Béthune fait un coude à l'extrémité nord du terroir de Sailly-la-Bourse, c'est, selon la légende, pour éviter la Fontaine hideuse, maudite depuis la veille de la Noël 1493 lorsqu'elle eût englouti un convoi de voyageurs dans ses profondeurs insondables. Pas un brin d'herbe ne poussa depuis, pas un poisson ne fendit ses eaux qui acquirent la réputation de glacer les cœurs...
La route de joignant Lille à Béthune partait autrefois du moulin de Bellenville, en serpentant à travers des mares et des fossés, droit au mont de Beuvry. Elle était, entre ces deux endroits, en bien mauvais état pendant la saison pluvieuse, parce que le terrain y est marécageux et tourbeux.
Les habitants de Vermelles, de Cambrin et d'Annequin se rendant au marché de Béthune, devaient alors y transporter leurs produits à dos de cheval ou à demi-chargement de voiture. Le coche qui y passait deux fois par mois, avait soin de prendre à La Bassée, au Cheval Rouge, deux bons chevaux de relais, et ses six chevaux flamands, aux jours pluvieux, avaient bien de la peine à franchir ce passage.
Or, en l'an 1493, la veille de Noël, une pluie fine et glaciale tombant toute la matinée, avait fondu la neige qui couvrait la terre depuis huit jours, et rendait cet endroit difficile et dangereux. A cause des fêtes de Noël, le coche était bondé de voyageurs. Deux chartreux, deux nonnes, et deux moines, emplissaient le coupé ; quatre bons marchands se serraient dans l'intérieur à côté de deux jeunes fiancés ; l'impériale regorgeait de bagages et de marchandises.
Le phaéton, trompé par la lueur vacillante d'un feu follet, quitta la route empierrée et la voiture s'embourba. Sous le fouet et les jurons du conducteur, les chevaux se cabraient, frémissaient, piaffaient, mais le coche ne bougeait pas. Les hommes descendirent et délibérèrent. Les moines et les chartreux prirent chacun une roue, leurs bras nerveux se tendirent, les jantes craquèrent ; le coche ne bougea pas davantage. Les marchands et les religieux firent un suprême effort, mais encore en vain. "Que le diable emporte tout, dit le cocher, hors de lui même !"
Quand les moines, les chartreux et les marchands voulurent rebrousser chemin, ils sentirent qu'ils s'enlisaient, que l'eau et la boue leur montaient jusqu'aux genoux. Les malheureux, désespérés, glacés d'effroi, s'enfonçaient toujours lentement, graduellement, fatalement. Déjà l'enlisement gagnait leur poitrine. "Salva nos Domine ", dit une voix. "Miserere mei", dirent les moines. Et des lèvres brûlantes des marchands sortaient les noms bénis de fils et d'épouses.
Quand, vers minuit, entre deux nuages, la lune apparut, on ne vit plus que l'impériale du coche et des bras s'agitant convulsivement au-dessus de l'abîme dans lequel les nonnes étaient descendues évanouies, et les fiancés endormis, rêvant à l'hyménée. La neige recommença à tomber pour couvrir les victimes d'un blanc linceul. Deux pêcheurs qui tendaient près de là leurs filets, assistèrent pétrifiés à cette scène lugubre ; ils coururent, revenus à eux-mêmes, conter l'aventure à Beuvry. La foule, venant de toute la contrée, ne vit au milieu du grand chemin vert, au lieu du sinistre, qu'une fontaine de plus de 200 pieds de tour, claire, bleue, ovale, semblable à l'œil immense d'un monstre souterrain guettant sa proie.
On voulut sonder la fontaine : tous les câbles de la contrée, bout à bout, n'en trouvèrent pas le fond. On voulut, pour leur donner la sépulture, pour leur dire les prières des morts, pour qu'un ami pût venir sur leurs tombes, arracher les victimes au gouffre béant ; mais l'abîme est sans fond, et, malgré tous les efforts, il n'a rendu ni un cadavre, ni un lambeau de froc. On l'appela "la Fontaine hideuse". Depuis ce jour lamentable, tous les ans, dans la nuit de Noël, de la onzième à la douzième heure, on entend sans cesse au fond de la Fontaine hideuse, claquer le fouet d'un postillon, et, les âmes pieuses voient dans une sorte de coche lumineux : Jésus dans la crèche, Joseph et Marie, l'âne, les bœufs, les bergers et, l'étoile.
Depuis quatre siècles, pas un brin d'herbe n'a poussé dans la fontaine, pas un poisson n'a fendu ses eaux, pas une goutte de son onde n'a été réchauffée par les feux des étés les plus brûlants. Tous les monts de la Savoie ne pourraient combler cet abîme ! Tout le foin de la Normandie y disparaîtrait en un clin d'œil, comme englouti par un monstre invisible !
Deux tourbiers sont perclus aujourd'hui pour s'être baignés dans la fontaine. Ils ne doivent la vie qu'à la précaution qu'ils avaient prise de s'être fait attacher par une corde à l'aide de laquelle on les retira du danger qu'ils couraient de disparaître aussi. Malheur à ceux qui se sont désaltérés à la Fontaine, ils n'ont jamais connu les joies de l'hymen, ou les ont oubliées s'ils les avaient éprouvées déjà : quelques gouttes de son eau glacent encore les plus férus d'amour.
Que de jouvenceaux prêts à aller à l'autel ont pris le chemin du cloître ou du monastère. Les abbayes de Gonnay et de Choques en comptèrent par certaines. Que d'amantes jalouses ont glacé, avec de l'eau de la fontaine, malicieusement, méchamment le cœur de leurs amants !
Le propriétaire actuel de l'ancienne abbaye de Choques – village situé à une demi-lieue de Béthune – a retrouvé on 1866 sous le taillis d'un bosquet formé sur les ruines des bâtiments de ce monastère, six pierres tombales en marbre blanc et en grès sculpté encore visibles aujourd'hui, de Francicus Pruvost, d'Andreas Dessain, de Ludovicus Gouillart, d'Elegicus de Baillencourt-Courcol, d'Ambroise Rattel et de Prosper Bonvalet, pieuse relique, morts dans cet asile de paix en odeur de sainteté, grâce à l'eau miraculeuse de la Fontaine hideuse, suivant l'épitaphe libellée en latin.
Depuis que cette source est là béante, la route de Lille à Béthune fait un coude à l'extrémité Nord du terroir de Sailly-la-Bourse, les voitures ne passent plus par Werquin pour se rendre à Béthune, et les roseaux, la ciguë aquatique croissent dans les mares du Grand Chemin Vert qui partait, avant la Fontaine hideuse, d'Annequin au mont de Beuvry.
[1055369]
titevero (FR1) [None]
:: March 24, 2013, 6:33 p.m.
La pierre du Diable et le pont de Toulon - Dettey (71190) /Toulon-sur-Arroux (71320)
D'après la légende populaire, la Pierre-du-Diable, fut destinée à former la clef de voûte du pont de Toulon-sur-Arroux, et là intervient un de ces innombrables contrats passés entre les entrepreneurs besogneux et le démon.
Satan, affriandé par là perspective de la prise de possession d'une âme, guettait l'embarras où se trouverait le constructeur du pont de Toulon, à bout dé ressources et d'expédients pour lui marchander son concours. Le démon, on le sait, est sans vergogne, il osa demander au pauvre homme, qui ? Sa fille. Larmes et protestations tout échoua. En vain le maçon jura qu'elle était promise et le jour des noces fixé; raison de plus pour Satan de faire coup double. Force fut de lui céder. Aux termes du marché, le démon devait transporter la pierre et fermer la voûte avant le chant du coq, suivant l'usage. Il l'avait équilibrée sur ses robustes épaules et enfoncé dans la masse ses doigts crochus. Il partait à grande vitesse, certain d'avoir avance sur l'heure et escomptant ses profits. Tout était donc perdu, l'âme et le mariage. Le malin, cette fois, avait trouvé plus fin que lui l'amant veillait. Pendant que dans la nuit sombre, Satan fait ses gambades, un cri retentissant le glace d'effroi la pierre qu'il transportait tombe dans les champs de Dettey. C'était le fiancé de la jeune fille qui avait réveillé le coq avant l'heure. Charme et marché sont rompus Satan s'enfuit confondu et la noce se fit.
Ce n'est pas tout. La diablesse, la fée du diable, emportait en même temps son tablier rempli de sable pour confectionner le mortier. Le chant du coq agit sur elle comme sur son mari et, les coins du tablier glissèrent de ses mains, le sable, en tombant forma un grand tumulus, le tumulus des Mancey, nom de la ferme. Les paysans, comme preuve, font remarquer que cet amoncellement n'est composé que de sable les géologues prétendent que ce sol n'est qu'un composé de grains de granit délité les archéologues ajoutent que ce tumulus, ainsi que celui de Montfaucon, situé à peu de distance, et dont la fouille a appuyé leur thèse, est un des tertres funéraires élevés sur un entassement de corps morts après la défaite des Helvètes par César, qui eut lieu en ces parages. L'empreinte des griffes du diable et de son dos est restée sur le roc, la mousse n'y pousse jamais, dit-on. La trace des griffes est produite par des fissures, celle de son dos est un ancien bassin qu'on croirait même creusé de main d'homme, objet peut-être de pratiques superstitieuses supprimées par le christianisme.

Les fauves sont l'objet d'un petit nombre de récits.
Suivant la tradition de la Savoie, le diable avait pris, pour ravager la contrée, la forme d'un énorme sanglier ; Amédée II, le comte Rouge, le poursuivit dans la forêt de Lones et engagea avec lui une lutte terrible ; son coursier épouvanté se cabra, s'élança au plus profond des bois et quand il s'abattit, son maître se fit une blessure dont il mourut.
Le seigneur de Langin fut plus heureux contre un autre sanglier qui dévastait le pays, mettait les voyageurs en pièces et qui était aussi une incarnation de Satan. Il le rencontra un jour à la chasse ; mais le monstre dévora le varlet, le piqueur et blessa le seigneur d'un coup de boutoir. Le blessé fit alors vœu, s'il échappait à la mort, d'élever une chapelle sur l'emplacement même où le sanglier l'avait frappé.
Le sabbat du diable et des sorciers

Le diable se montre aussi sous le couvert, soit pour y conclure des pactes, soit pour présider aux sabbats qui s'y tenaient naguère encore.
Dans la Puisaye, c'est au gros chêne du carrefour que se rendent, avant minuit, ceux qui veulent devenir sorciers. A minuit précis, ils immolent une poule noire en criant par trois fois : "Belzébuth ! viens, je me donne à toi !". Aussitôt le diable apparait, et quand l'homme a mis une croix sur un écrit par lequel il donne son âme, il est doué de tout pouvoir pour faire mal.
Pendant la nuit du 24 juin, Satan présidait dans le Bouie de los Mascos en Aveyron, la réunion des fées auxquelles on attribue des actes de sorcellerie ; il s'asseyait, puis il jouait du violon et faisait danser les fées jusqu'au jour.
Un procès de 1652 parle de danses que faisaient les sorcières au bois d'Enge près de Jodoigne.
Des sabbats se tenaient dans la nuit qui précédait les dimanches et les grandes fêtes, surtout celle de Noël, sur un plateau dans une forêt de châtaigniers au Crau di Bouki, dans la Suisses romande ; un vieillard disait que, de 1830 à 1840, on y entendait un grand bruit, mais que l'on n'osait aller voir ce que c'était.
Il y aune centaine d'années, plusieurs personnes affirmaient avoir vu des sabbats dans la forêt de Châtillon.
A Hautfays (Luxembourg belge), des sorcières habillées de blanc se réunissaient autrefois dans le taillis de Bricheau ; un bossu qui y passait les entendit chanter et se mêla à leurs ébats. Il eut la bonne fortune de leur plaire, et elles enlevèrent sa bosse. Mais un des compères qui, ayant appris l'aventure, s'était malencontreusement mêlé à elles, fut affublé de la bosses dont elles avaient, la veille, débarrassé son compagnon.
On raconte, dans les villages de la forêt de Clairvaux (Aube), des récits de sabbats qui se rapprochent de celui-ci : un ménétrier qui revient d'une noce, se voit tout à coup dans un bas-fond du sous-bois devant un grand feu d'épines qui projette des flammes fantastiques, près duquel des gens dansent, boivent, chantent, en surplis, en chemise, etc. On veut lui faire jouer une valse, mais troublé et tremblant, il commence un Inviolata. Aussitôt, il reçoit un grand soufflet, qui l'étend par terre tout étourdi, et quand il se relève, diables et sorciers ont disparu ; il ne reste plus qu'un tas de cendres noires et mouillées.
Les paysans de l'Aveyron disent qu'en temps d 'orage, on voit les sorcières à califourchon sur une branche d'arbre que traîne à travers les sentiers de la forêt un attelage de chats noirs.
D'après la légende populaire, la Pierre-du-Diable, fut destinée à former la clef de voûte du pont de Toulon-sur-Arroux, et là intervient un de ces innombrables contrats passés entre les entrepreneurs besogneux et le démon.
Satan, affriandé par là perspective de la prise de possession d'une âme, guettait l'embarras où se trouverait le constructeur du pont de Toulon, à bout dé ressources et d'expédients pour lui marchander son concours. Le démon, on le sait, est sans vergogne, il osa demander au pauvre homme, qui ? Sa fille. Larmes et protestations tout échoua. En vain le maçon jura qu'elle était promise et le jour des noces fixé; raison de plus pour Satan de faire coup double. Force fut de lui céder. Aux termes du marché, le démon devait transporter la pierre et fermer la voûte avant le chant du coq, suivant l'usage. Il l'avait équilibrée sur ses robustes épaules et enfoncé dans la masse ses doigts crochus. Il partait à grande vitesse, certain d'avoir avance sur l'heure et escomptant ses profits. Tout était donc perdu, l'âme et le mariage. Le malin, cette fois, avait trouvé plus fin que lui l'amant veillait. Pendant que dans la nuit sombre, Satan fait ses gambades, un cri retentissant le glace d'effroi la pierre qu'il transportait tombe dans les champs de Dettey. C'était le fiancé de la jeune fille qui avait réveillé le coq avant l'heure. Charme et marché sont rompus Satan s'enfuit confondu et la noce se fit.
Ce n'est pas tout. La diablesse, la fée du diable, emportait en même temps son tablier rempli de sable pour confectionner le mortier. Le chant du coq agit sur elle comme sur son mari et, les coins du tablier glissèrent de ses mains, le sable, en tombant forma un grand tumulus, le tumulus des Mancey, nom de la ferme. Les paysans, comme preuve, font remarquer que cet amoncellement n'est composé que de sable les géologues prétendent que ce sol n'est qu'un composé de grains de granit délité les archéologues ajoutent que ce tumulus, ainsi que celui de Montfaucon, situé à peu de distance, et dont la fouille a appuyé leur thèse, est un des tertres funéraires élevés sur un entassement de corps morts après la défaite des Helvètes par César, qui eut lieu en ces parages. L'empreinte des griffes du diable et de son dos est restée sur le roc, la mousse n'y pousse jamais, dit-on. La trace des griffes est produite par des fissures, celle de son dos est un ancien bassin qu'on croirait même creusé de main d'homme, objet peut-être de pratiques superstitieuses supprimées par le christianisme.

Les fauves sont l'objet d'un petit nombre de récits.
Suivant la tradition de la Savoie, le diable avait pris, pour ravager la contrée, la forme d'un énorme sanglier ; Amédée II, le comte Rouge, le poursuivit dans la forêt de Lones et engagea avec lui une lutte terrible ; son coursier épouvanté se cabra, s'élança au plus profond des bois et quand il s'abattit, son maître se fit une blessure dont il mourut.
Le seigneur de Langin fut plus heureux contre un autre sanglier qui dévastait le pays, mettait les voyageurs en pièces et qui était aussi une incarnation de Satan. Il le rencontra un jour à la chasse ; mais le monstre dévora le varlet, le piqueur et blessa le seigneur d'un coup de boutoir. Le blessé fit alors vœu, s'il échappait à la mort, d'élever une chapelle sur l'emplacement même où le sanglier l'avait frappé.
Le sabbat du diable et des sorciers

Le diable se montre aussi sous le couvert, soit pour y conclure des pactes, soit pour présider aux sabbats qui s'y tenaient naguère encore.
Dans la Puisaye, c'est au gros chêne du carrefour que se rendent, avant minuit, ceux qui veulent devenir sorciers. A minuit précis, ils immolent une poule noire en criant par trois fois : "Belzébuth ! viens, je me donne à toi !". Aussitôt le diable apparait, et quand l'homme a mis une croix sur un écrit par lequel il donne son âme, il est doué de tout pouvoir pour faire mal.
Pendant la nuit du 24 juin, Satan présidait dans le Bouie de los Mascos en Aveyron, la réunion des fées auxquelles on attribue des actes de sorcellerie ; il s'asseyait, puis il jouait du violon et faisait danser les fées jusqu'au jour.
Un procès de 1652 parle de danses que faisaient les sorcières au bois d'Enge près de Jodoigne.
Des sabbats se tenaient dans la nuit qui précédait les dimanches et les grandes fêtes, surtout celle de Noël, sur un plateau dans une forêt de châtaigniers au Crau di Bouki, dans la Suisses romande ; un vieillard disait que, de 1830 à 1840, on y entendait un grand bruit, mais que l'on n'osait aller voir ce que c'était.
Il y aune centaine d'années, plusieurs personnes affirmaient avoir vu des sabbats dans la forêt de Châtillon.
A Hautfays (Luxembourg belge), des sorcières habillées de blanc se réunissaient autrefois dans le taillis de Bricheau ; un bossu qui y passait les entendit chanter et se mêla à leurs ébats. Il eut la bonne fortune de leur plaire, et elles enlevèrent sa bosse. Mais un des compères qui, ayant appris l'aventure, s'était malencontreusement mêlé à elles, fut affublé de la bosses dont elles avaient, la veille, débarrassé son compagnon.
On raconte, dans les villages de la forêt de Clairvaux (Aube), des récits de sabbats qui se rapprochent de celui-ci : un ménétrier qui revient d'une noce, se voit tout à coup dans un bas-fond du sous-bois devant un grand feu d'épines qui projette des flammes fantastiques, près duquel des gens dansent, boivent, chantent, en surplis, en chemise, etc. On veut lui faire jouer une valse, mais troublé et tremblant, il commence un Inviolata. Aussitôt, il reçoit un grand soufflet, qui l'étend par terre tout étourdi, et quand il se relève, diables et sorciers ont disparu ; il ne reste plus qu'un tas de cendres noires et mouillées.
Les paysans de l'Aveyron disent qu'en temps d 'orage, on voit les sorcières à califourchon sur une branche d'arbre que traîne à travers les sentiers de la forêt un attelage de chats noirs.
[1055370]
titevero (FR1) [None]
:: March 24, 2013, 7:03 p.m.
Le Gothard
[IMG]https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSRx1r3W7ty2bgCfOiAOwnvp5KSpBKuT fOyQ_6DX_B3HG9XgHdHSA[/IMG]
Première citation du Col du Gothard, alors appelé Montre Tremulo. Toutefois, le commerce y transiterait depuis plusieurs siècles déjà. Les historiens supposent que le col était régulièrement utilisé dès l'âge du Fer.
C'est d'ailleurs sans doute aux voyageurs que se consacre la chapelle érigée sur le col, entre 1166 et 1230. La plus ancienne description d'un voyage par le Gothard remonte à 1234 et, en 1237, sont publiés les premiers statuts d'une association de transporteurs, celle des muletiers d'Osco.
À cette époque, le passage est pourtant acrobatique et particulièrement dangereux. Il se révèle pourtant nécessaire, bientôt vital, aux éleveurs uranais qui prennent l'habitude de l'emprunter pour acheminer leur bétail jusqu'à Milan. Faciliter l'accès vers l'Italie du Nord devient rapidement une obsession.
Une légende raconte la construction du pont qui ouvre le premier passage dans le Gothard. Elle remonte au début du XIIIème siècle.
À Uri, près du village de Göschenen, les gorges de la Schöllenen constituent l'obstacle majeur dans le massif, dominées de falaises vertigineuses, hautes de plusieurs centaines de mètres, qui n'offrent aucun appui pour y construire un sentier tandis qu'un torrent tumultueux gronde en contrebas.
C'est alors le Diable qui jette un pont en pierre au-dessus des gorges infranchissables. En échange, il exige la vie du premier habitant qui franchira l'édifice.
 Le Pont du Diable, 1780
Le Pont du Diable, 1780
 Le Pont du Diable ,1803-1804
Le Pont du Diable ,1803-1804
Mais le Diable a trouvé plus malin que lui. Les habitants de Göschenen sacrifient... un bouc. Le diable qui, fou de colère, précipite alors un rocher gigantesque sur le pont, mais rate sa cible.

Le pont est baptisé « Pont du Diable » (Teufelsbrücke). Il ouvre la voie à la fantastique épopée du Gothard.
C'est un ouvrage remarquable, petit bijou de ferronnerie complété de passerelles de bois accrochées par des anneaux métalliques fixés le long des falaises.
(Plus plausiblement, la construction du pont est attribuée aux Walser qui réalisèrent d'autres ouvrages remarquables en Valais avant de rejoindre cette vallée uranaise, sans doute en empruntant la Furka.)
Rapidement, ce nouveau passage dans le Gothard se métamorphose en véritable route commerciale qui voit transiter bétail, viandes, peaux, beurre et fromage des vallées suisses ainsi que le précieux sel de Méditerranée.
Le nord et le sud se rapprochent. Les retombées commerciales sont importantes, la région s'enrichit.
Le tunnel de base du Saint Gothard
Depuis aujourd’hui 15 octobre 2010 à 14:00, le tunnel de base du Saint Gothard est percé et devient le plus long tunnel ferroviaire du monde avec 57 kilomètres sous la totalité du massif alpin du Gothard.
Le percement du tunnel avait commencé en 1993 mais ce n’est qu’en 2017 qu’il sera enfin terminé pour laisser passer les premiers trains qui permettrons de relier Zürich à Milan en une heure de moins qu’actuellement.
Toutefois il ne faut pas oublier que le projet AlpTransit comprendre également le percement de deux autres tunnels: le tunnel de Ceneri, entre Lugano et Bellinzona, et le tunnel du Zimmerberg, entre Zürich et Zug.
[IMG]https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSRx1r3W7ty2bgCfOiAOwnvp5KSpBKuT fOyQ_6DX_B3HG9XgHdHSA[/IMG]
Première citation du Col du Gothard, alors appelé Montre Tremulo. Toutefois, le commerce y transiterait depuis plusieurs siècles déjà. Les historiens supposent que le col était régulièrement utilisé dès l'âge du Fer.
C'est d'ailleurs sans doute aux voyageurs que se consacre la chapelle érigée sur le col, entre 1166 et 1230. La plus ancienne description d'un voyage par le Gothard remonte à 1234 et, en 1237, sont publiés les premiers statuts d'une association de transporteurs, celle des muletiers d'Osco.
À cette époque, le passage est pourtant acrobatique et particulièrement dangereux. Il se révèle pourtant nécessaire, bientôt vital, aux éleveurs uranais qui prennent l'habitude de l'emprunter pour acheminer leur bétail jusqu'à Milan. Faciliter l'accès vers l'Italie du Nord devient rapidement une obsession.
Une légende raconte la construction du pont qui ouvre le premier passage dans le Gothard. Elle remonte au début du XIIIème siècle.
À Uri, près du village de Göschenen, les gorges de la Schöllenen constituent l'obstacle majeur dans le massif, dominées de falaises vertigineuses, hautes de plusieurs centaines de mètres, qui n'offrent aucun appui pour y construire un sentier tandis qu'un torrent tumultueux gronde en contrebas.
C'est alors le Diable qui jette un pont en pierre au-dessus des gorges infranchissables. En échange, il exige la vie du premier habitant qui franchira l'édifice.
 Le Pont du Diable, 1780
Le Pont du Diable, 1780 Le Pont du Diable ,1803-1804
Le Pont du Diable ,1803-1804Mais le Diable a trouvé plus malin que lui. Les habitants de Göschenen sacrifient... un bouc. Le diable qui, fou de colère, précipite alors un rocher gigantesque sur le pont, mais rate sa cible.

Le pont est baptisé « Pont du Diable » (Teufelsbrücke). Il ouvre la voie à la fantastique épopée du Gothard.
C'est un ouvrage remarquable, petit bijou de ferronnerie complété de passerelles de bois accrochées par des anneaux métalliques fixés le long des falaises.
(Plus plausiblement, la construction du pont est attribuée aux Walser qui réalisèrent d'autres ouvrages remarquables en Valais avant de rejoindre cette vallée uranaise, sans doute en empruntant la Furka.)
Rapidement, ce nouveau passage dans le Gothard se métamorphose en véritable route commerciale qui voit transiter bétail, viandes, peaux, beurre et fromage des vallées suisses ainsi que le précieux sel de Méditerranée.
Le nord et le sud se rapprochent. Les retombées commerciales sont importantes, la région s'enrichit.
Le tunnel de base du Saint Gothard
Depuis aujourd’hui 15 octobre 2010 à 14:00, le tunnel de base du Saint Gothard est percé et devient le plus long tunnel ferroviaire du monde avec 57 kilomètres sous la totalité du massif alpin du Gothard.
Le percement du tunnel avait commencé en 1993 mais ce n’est qu’en 2017 qu’il sera enfin terminé pour laisser passer les premiers trains qui permettrons de relier Zürich à Milan en une heure de moins qu’actuellement.
Toutefois il ne faut pas oublier que le projet AlpTransit comprendre également le percement de deux autres tunnels: le tunnel de Ceneri, entre Lugano et Bellinzona, et le tunnel du Zimmerberg, entre Zürich et Zug.
[1055423]
titevero (FR1) [None]
:: March 25, 2013, 2:25 p.m.
Cascade du Voile de la Mariée Salazie et sa légende île de La Réunion

Le Voile de La Mariée, cette cascade vertigineuse se trouve à un kilomètre de Salazie, sur la route d'Hell-Bourg, vous ne pouvez pas la manquer.
 Vue du ciel
Vue du ciel

Subdivisé en plusieurs chutes, elle tombe de hauteurs souvent masquées par les nuages jusqu'à la ravine située en contrebas de la route. Elle doit son nom au fait que l'effet visuel de cette longue et fine chute d'eau évoque le tulle vaporeux d'un voile de mariée.

Le cirque de Salazie doit ses cascades vertigineuses à ses fabuleuses précipitations, encombrants les livres de records.
La légende du Voile de La Mariée
La légende raconte qu’à la fin de l’esclavage en 1848, un petit propriétaire des bas, Monsieur Armand, vendit ses terres et parti, comme tant d’autres, dans les hauts à Salazie, pour racheter moins cher plus de terre à cultiver.
M. Armand était besogneux, et passait ses journées entières à travailler sans relâche ses champs. Il était marié à la plus belle femme qu’il était permis de rencontrer. Il en était amoureux fou, tant elle était belle, mais également tant elle était douce et gentille. Malheureusement, un jour elle décéda. Il était tellement triste qu’il travailla encore deux fois plus ses terres agricoles. Ils avaient eu une fille, Amanda, et sa femme décédée lui avait fait promettre avant de mourir de bien s’occuper d’elle. C’est ce qu’il fit, et plus les années passaient, plus Amanda devenait à son tour belle, gentille et intelligente, ce qui ne manqua pas de rendre tellement heureux ce père dont l’absence de sa femme chérie était ainsi compensée grâce à la présence de cette fille qui en était le portrait craché. Ainsi, l’homme refusait toutes les demandes en mariage pour sa fille, trouvant toujours un défaut chez les prétendants.
Un beau jour, un homme vint chercher du travail chez Monsieur Armand, et celui-ci l’engagea comme jardinier. L’homme qui se prénommait Henrio, était très bon jardinier, et Monsieur Armand lui offrit donc de s’installer dans une petite dépendance au fond du jardin. Un matin Henrio offrit une magnifique rose à Amanda. Celle-ci, surprise, en vint à espionner le pauvre jardinier, qui était toujours si mal habillé et l’air si fatigué. Elle l’espionna un jour à la fenêtre de sa case, et l’aperçut alors en-train de troquer ses habits de jardinier contre un magnifique costume que bien peu d’hommes pourraient s’offrir.
Elle lui fit glisser le lendemain matin un mot lui demandant quel était son secret. Celui-ci lui répondit par ce même procédé " l’amour. Rendez-vous ce soir devant le parvis de rose ".
La curiosité d’Amanda étant très forte, elle se rendit à ce rendez-vous. L’homme était là, chichement vêtu, et alors lui expliqua toute son histoire. Il était un ancien riche propriétaire de la cote, et ayant entendu parler d’une jeune fille à la beauté digne des dieux, il décida de vendre ses terres et de venir conquérir cette belle et gentille demoiselle. Il lui fit la cour pendant des heures, et Amanda finit par tomber amoureuse de ce beau jardinier pas comme les autres.
Les jours passaient, et leur idylle était parfaite. Mais las de vivre leur amour en cachette ils décidèrent un jour d’aller trouver Monsieur Armand pour tout lui dire, et ainsi faire qu’Henrio épouse Amanda. Mais cela ne se passa pas de la meilleure façon. Monsieur Armand congédia sur le champ le jardinier, et enferma sa fille dans sa chambre pendant une semaine. Amanda réussit néanmoins à s’échapper, et retrouver la nuit même le beau Henrio. Tout deux allèrent trouver le curé pour qu’il les marie. La cérémonie fut programmée à 6h du matin. Mais monsieur Armand, se levant comme tous les jours à 5h trouva la chambre de sa fille vide. Il la chercha partout, jusqu’à l’église où en ouvrant les portes , il comprit ce qui venait de se passer. Il cria son désespoir, et Amanda, prise de panique se mit à courir, courir, ne voyant rien devant elle à cause du magnifique voile blanc de mariée qu’Henrio lui avait offert pour la cérémonie. Elle ne voyait rien, et elle finit donc par chuter dans un profond précipice. Le voile s’accrochât à une branche d’arbre, et quand Monsieur Armand vit le voile ainsi agrafé, il comprit alors ce qui venait de se passer et pleura, pleura, arrosant le voile de tant de larmes.
Aujourd’hui, les larmes de M. Armant coulent en cascade sur ce que l’on appelle, le voile de la mariée à Salazie. Il y a quelques années, le débit de la cascade était si important que la vapeur d'eau donnait un effet ressemblant étrangement à un voile.

Le Voile de La Mariée, cette cascade vertigineuse se trouve à un kilomètre de Salazie, sur la route d'Hell-Bourg, vous ne pouvez pas la manquer.
 Vue du ciel
Vue du ciel
Subdivisé en plusieurs chutes, elle tombe de hauteurs souvent masquées par les nuages jusqu'à la ravine située en contrebas de la route. Elle doit son nom au fait que l'effet visuel de cette longue et fine chute d'eau évoque le tulle vaporeux d'un voile de mariée.

Le cirque de Salazie doit ses cascades vertigineuses à ses fabuleuses précipitations, encombrants les livres de records.
La légende du Voile de La Mariée
La légende raconte qu’à la fin de l’esclavage en 1848, un petit propriétaire des bas, Monsieur Armand, vendit ses terres et parti, comme tant d’autres, dans les hauts à Salazie, pour racheter moins cher plus de terre à cultiver.
M. Armand était besogneux, et passait ses journées entières à travailler sans relâche ses champs. Il était marié à la plus belle femme qu’il était permis de rencontrer. Il en était amoureux fou, tant elle était belle, mais également tant elle était douce et gentille. Malheureusement, un jour elle décéda. Il était tellement triste qu’il travailla encore deux fois plus ses terres agricoles. Ils avaient eu une fille, Amanda, et sa femme décédée lui avait fait promettre avant de mourir de bien s’occuper d’elle. C’est ce qu’il fit, et plus les années passaient, plus Amanda devenait à son tour belle, gentille et intelligente, ce qui ne manqua pas de rendre tellement heureux ce père dont l’absence de sa femme chérie était ainsi compensée grâce à la présence de cette fille qui en était le portrait craché. Ainsi, l’homme refusait toutes les demandes en mariage pour sa fille, trouvant toujours un défaut chez les prétendants.
Un beau jour, un homme vint chercher du travail chez Monsieur Armand, et celui-ci l’engagea comme jardinier. L’homme qui se prénommait Henrio, était très bon jardinier, et Monsieur Armand lui offrit donc de s’installer dans une petite dépendance au fond du jardin. Un matin Henrio offrit une magnifique rose à Amanda. Celle-ci, surprise, en vint à espionner le pauvre jardinier, qui était toujours si mal habillé et l’air si fatigué. Elle l’espionna un jour à la fenêtre de sa case, et l’aperçut alors en-train de troquer ses habits de jardinier contre un magnifique costume que bien peu d’hommes pourraient s’offrir.
Elle lui fit glisser le lendemain matin un mot lui demandant quel était son secret. Celui-ci lui répondit par ce même procédé " l’amour. Rendez-vous ce soir devant le parvis de rose ".
La curiosité d’Amanda étant très forte, elle se rendit à ce rendez-vous. L’homme était là, chichement vêtu, et alors lui expliqua toute son histoire. Il était un ancien riche propriétaire de la cote, et ayant entendu parler d’une jeune fille à la beauté digne des dieux, il décida de vendre ses terres et de venir conquérir cette belle et gentille demoiselle. Il lui fit la cour pendant des heures, et Amanda finit par tomber amoureuse de ce beau jardinier pas comme les autres.
Les jours passaient, et leur idylle était parfaite. Mais las de vivre leur amour en cachette ils décidèrent un jour d’aller trouver Monsieur Armand pour tout lui dire, et ainsi faire qu’Henrio épouse Amanda. Mais cela ne se passa pas de la meilleure façon. Monsieur Armand congédia sur le champ le jardinier, et enferma sa fille dans sa chambre pendant une semaine. Amanda réussit néanmoins à s’échapper, et retrouver la nuit même le beau Henrio. Tout deux allèrent trouver le curé pour qu’il les marie. La cérémonie fut programmée à 6h du matin. Mais monsieur Armand, se levant comme tous les jours à 5h trouva la chambre de sa fille vide. Il la chercha partout, jusqu’à l’église où en ouvrant les portes , il comprit ce qui venait de se passer. Il cria son désespoir, et Amanda, prise de panique se mit à courir, courir, ne voyant rien devant elle à cause du magnifique voile blanc de mariée qu’Henrio lui avait offert pour la cérémonie. Elle ne voyait rien, et elle finit donc par chuter dans un profond précipice. Le voile s’accrochât à une branche d’arbre, et quand Monsieur Armand vit le voile ainsi agrafé, il comprit alors ce qui venait de se passer et pleura, pleura, arrosant le voile de tant de larmes.
Aujourd’hui, les larmes de M. Armant coulent en cascade sur ce que l’on appelle, le voile de la mariée à Salazie. Il y a quelques années, le débit de la cascade était si important que la vapeur d'eau donnait un effet ressemblant étrangement à un voile.
[1055430]
Bellalouna2 [None]
:: March 25, 2013, 3:03 p.m.
J'ai eu la chance de la voir en vrai la cascade du voile de la mariée, et c'est vraiment une sensation particulière, ne serait-ce que la beauté.
[1055431]
titevero (FR1) [None]
:: March 25, 2013, 3:23 p.m.
Bellalouna2 a écrit: »J'ai eu la chance de la voir en vrai la cascade du voile de la mariée, et c'est vraiment une sensation particulière, ne serait-ce que la beauté.
coucou Bella , et mon topic la définie bien ou pas dans ce cas?
[1055433]
titevero (FR1) [None]
:: March 25, 2013, 3:35 p.m.
Les cascades d'Edelfrauengrab-Wasserfälle

Si vous souhaitez entreprendre la randonnée vers le sommet de la crête du Karlsruher Grat, vous passerez dans un premier temps par les 7 cascades situées dans un cadre idyllique, qui vous accompagneront le long des 180 marches à travers la vallée de Gottschlägtal.
La légende des cascades Edelfrauengrab-Wasserfälle:
Les cascades tiennent leur nom d'une vieille légende. Pendant les croisades, le chevalier Wolf von Bosenstein, parti en Terre Sainte avec son armée. Il ne put y emmener sa femme. Celle-ci resta au pays. Elle n'était pas très fidèle à leur union et faisait la noce avec son amant. Un jour, une mendiante accompagnée de ses sept enfants quasiment affamés, vint taper à la porte du château de Bosenstein et demanda l'aumône. La mendiante fut réprimandée à cause de ses sept enfants par la très orgueilleuse châtelaine qui la chassa expressément. La mendiante lui lança le sort suivant: "Tu enfanteras d'un seul coup sept enfants, tous aussi misérables que ceux que tu viens de rejeter". Le sort fut exécuté. Un jour, la châtelaine enfanta sept enfants. Dans sa détresse, elle ne vit pas d'autre solution que d'ordonner à sa servante de mettre les enfants dans un sac et de les noyer dans l'étang du château. A ce moment précis, la servante rencontra le châtelain qui revenait des croisades. Il lui demanda ce qu'elle était entrain de faire. Alors qu'elle essayait de lui faire croire qu'elle était sur le point de noyer des chiots, le châtelain vérifia lui même le contenu des sacs. Pris de colère, le chevalier ordonna à la servante de retourner au château, d'informer la châtelaine qu'elle avait bien rempli sa mission. Le chevalier Wolf lui-même emmena les enfants chez des parents à lui, dans le château-fort de Hohenfels en Alsace et les fit éduquer entre autre au jeu de la harpe. Sept ans plus tard, Wolf fit emmener les septs enfants à une fête qui eu lieu au château de Bosenstein. Habillés de haillons, ils jouèrent de la harpe et chantèrent leur destin tragique. Un des hôtes de la fête demanda ce qu'une telle mère indigne méritait, et la châtelaine donna la réponse suivante: "Une telle mère doit être emmurée et nourrie de pain et d'eau." Son mari rempli de rage lui répondit sur le champ: "Ainsi soit-il, tu viens de prononcer ton propre jugement. Qu'il soit appliqué." Wolf laissa emmurer sa femme vivante dans une grotte baignée d'eau, avec pour seule nourriture du pain et de l'eau. Plus tard, pour mettre un terme aux souffrances de sa femme, il ordonna de faire pénétrer la rivière dans la grotte. Depuis lors, la grotte rocheuse fut baptisée "Edelfrauengrab".

Si vous souhaitez entreprendre la randonnée vers le sommet de la crête du Karlsruher Grat, vous passerez dans un premier temps par les 7 cascades situées dans un cadre idyllique, qui vous accompagneront le long des 180 marches à travers la vallée de Gottschlägtal.
La légende des cascades Edelfrauengrab-Wasserfälle:
Les cascades tiennent leur nom d'une vieille légende. Pendant les croisades, le chevalier Wolf von Bosenstein, parti en Terre Sainte avec son armée. Il ne put y emmener sa femme. Celle-ci resta au pays. Elle n'était pas très fidèle à leur union et faisait la noce avec son amant. Un jour, une mendiante accompagnée de ses sept enfants quasiment affamés, vint taper à la porte du château de Bosenstein et demanda l'aumône. La mendiante fut réprimandée à cause de ses sept enfants par la très orgueilleuse châtelaine qui la chassa expressément. La mendiante lui lança le sort suivant: "Tu enfanteras d'un seul coup sept enfants, tous aussi misérables que ceux que tu viens de rejeter". Le sort fut exécuté. Un jour, la châtelaine enfanta sept enfants. Dans sa détresse, elle ne vit pas d'autre solution que d'ordonner à sa servante de mettre les enfants dans un sac et de les noyer dans l'étang du château. A ce moment précis, la servante rencontra le châtelain qui revenait des croisades. Il lui demanda ce qu'elle était entrain de faire. Alors qu'elle essayait de lui faire croire qu'elle était sur le point de noyer des chiots, le châtelain vérifia lui même le contenu des sacs. Pris de colère, le chevalier ordonna à la servante de retourner au château, d'informer la châtelaine qu'elle avait bien rempli sa mission. Le chevalier Wolf lui-même emmena les enfants chez des parents à lui, dans le château-fort de Hohenfels en Alsace et les fit éduquer entre autre au jeu de la harpe. Sept ans plus tard, Wolf fit emmener les septs enfants à une fête qui eu lieu au château de Bosenstein. Habillés de haillons, ils jouèrent de la harpe et chantèrent leur destin tragique. Un des hôtes de la fête demanda ce qu'une telle mère indigne méritait, et la châtelaine donna la réponse suivante: "Une telle mère doit être emmurée et nourrie de pain et d'eau." Son mari rempli de rage lui répondit sur le champ: "Ainsi soit-il, tu viens de prononcer ton propre jugement. Qu'il soit appliqué." Wolf laissa emmurer sa femme vivante dans une grotte baignée d'eau, avec pour seule nourriture du pain et de l'eau. Plus tard, pour mettre un terme aux souffrances de sa femme, il ordonna de faire pénétrer la rivière dans la grotte. Depuis lors, la grotte rocheuse fut baptisée "Edelfrauengrab".
 https://www.youtube.com/watch?v=6lTBd4Njjrg
https://www.youtube.com/watch?v=6lTBd4Njjrg